La Décentralisation théâtrale dans la Région Hauts-de-France1945-2015 Premier volet: les acteurs «historiques» - 1945-1991 Colloque organisé par Pierre Longuenesse, Françoise Heulot-Petit et Pierre Rogez Laboratoire Textes et Cultures / Praxis et esthétique des arts EA4028, Université d’Artois Les mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2019 PRESENTATION Le mouvement général de la décentralisation théâtrale française est, depuis plusieurs décennies et encore aujourd’hui, largement documenté et analysé par le monde de la recherche (voir Abirached 1992 re-ed. 2005, Denizot 2005, Goetschel 2000, entre autres). À ces recherches s’adossent également nombres d’ouvrages touchant aux questions de démocratie culturelle ou d’éducation populaire (Lepage dir., 2012). Restent pourtant à faire, dans ce paysage critique foisonnant, des études monographiques sur certains territoires, voire sur des structures-clé de cette tranche d’histoire des politiques culturelles. De ce point de vue, la région Hauts-de-France (anciennement Nord/Pas de Calais d’un côté et Picardie de l’autre) a été à part entière, et peut-être plus que d’autres, partie prenante de ce que l’on appelle souvent – par nostalgie? – «l’aventure de la décentralisation». La naissance du CDN du Nord, en 1962, animé par André Reybaz, n’est que la partie la plus visible d’un mouvement qui a irrigué en profondeur le tissu social, professionnel, associatif, de la région, mettant en acte, en une dialectique propre à une époque, la rencontre et le croisement entre des aspirations et des pratiques diverses, artistiques et culturelles, donnant une existence concrète à cette utopie de service public de la culture telle qu’elle fut formulée à la Libération, et mise en place par Jeanne Laurent et ses successeurs. Puis, à partir des années 1990, la région connaît des mutations radicales. La fermeture des derniers puits de mine, en 1991, est le point d’aboutissement d’un long processus entamé depuis des décennies. À la même période, le paysage culturel change également du tout au tout: émergence du réseau des scènes nationales –7 Scènes Nationales dans la région, Le Channel/Calais, Culture Commune/Loos en Gohelle, Douai (bientôt Tandem Arras/Douai), Le Bateau-feu/Dunkerque, Le Manège/Maubeuge-Mons, Le Phénix/Valenciennes, La Rose des vents/Villeneuve d’Asq) – création du CDN de Béthune, qui s’ajoute à celui de Lille, ouverture de nouvelles universités dites «de proximité» (Littoral, Artois), émergence de lieux et projets alternatifs (les Maisons Folies, Droit de cité, pour n’en citer que deux des plus importants), d’autres encore. Paradoxalement, il semble que ces années 1990 soient le moment à la fois d’une consécration – celle d’une politique de décentralisation culturelle poursuivie et amplifiée par Jack Lang durant les deux septennats Mitterrand –, et en même temps des premiers signes d’un ébranlement profond des certitudes antérieures, et des tentatives de renouvellement de modèles jugés par certains obsolètes. Aujourd’hui – à l’heure où les régions changent de noms et de format, et à l’heure, aussi, du libéralisme triomphant (voir le numéro de Théâtre/Public n°207, 2013, titré Théâtre et néo-libéralisme ), – un état des lieux autant qu’un bilan de cette longue période devient plus qu’urgent. Pourtant, il n’existe pas dans cette région de «laboratoire des politiques publiques de la Culture» comme on peut en observer dans d’autres régions. Si des espaces subsistent dans lesquels est préservée une réflexion de fond sur ces politiques – le réseau Artoiscope, par exemple – on constate que le monde de la recherche universitaire régional s’est quant à lui jusqu’alors peu ou prou désintéressé de cette question. De fait, la mémoire collective se heurte aujourd’hui à des figures dont on ne connaît pas assez ou plus l’histoire: si l’on connaît les noms d’André Reybaz, de Cyril Robichez ou de Ronny Couteure, on serait bien en peine de mesurer exactement la nature et les enjeux de leur travail, des années 1960 aux années 1980 – sans parler de tous ceux qui ont été oubliés. Et quant aux mutations des années 1990, ce n’est que très récemment que des études se sont penchées – à titre d’exemple encore – sur le processus par lequel Jean-Louis Martin-Barbaz est arrivé à Béthune, ou sur celui qui a présidé à l’émergence de Culture Commune: deux événements pourtant marquants, caractéristiques d’une relance des politiques publiques de la culture dans le contexte de la crise du bassin minier. On poursuivra donc, durant ce-s colloque-s et/ou ces journées, deux objectifs: celui de transmettre une mémoire, d’une part, et celui de lancer des pistes de réflexion et d’évaluation, d’autre part. Il s’agit de faire œuvre de recherche – passant, sans doute, par l’exhumation et l’examen de nombreuses archives! – sur un passé plus ou moins récent; de donner la parole aussi à de «grands témoins» de ces choix artistiques et politiques; et en même temps de contribuer au débat actuel, et d’oser tenter des diagnostics sur les politiques d’aujourd’hui, en observant la manière dont certaines initiatives citoyennes fortes peuvent être actrices d’une démocratisation culturelle. AXES DE RECHERCHE On posera ainsi deux, ou peut-être trois, directions de travail: 1 – Les acteurs «historiques» de la décentralisation dans la région. Quel réseau a été mis en place, et par quelle tutelle, selon quelle logique politique? Qui furent-ils? Peut-on porter un regard fouillé sur le travail du Théâtre du Nord dans les années 50 et 60, ou du Théâtre Populaire des Flandres (Cyril Robichez), ou de la Maison de la Culture d’Amiens? Quid du concours des compagnies d’Arras, clin d’œil lointain aux jeux d’Arras d’une époque ancienne? Que dire des compagnies telles le théâtre de la Planchette, (Pierre-Etienne Heymann) ou le Carquois (Jacques Labarrière)? Quels furent les liens des uns et des autres avec les élus, la presse, les associations d’éducation populaire? Quelles formes prit, précisément, ce travail d’éducation populaire (notamment par les associations que furent Travail et Culture, les ATP, l’association Léo Lagrange, et d’autres)? Comment fut mise en œuvre cette politique d’accessibilité aux «œuvres capitales de l’humanité» (Malraux)? Quelle rencontre se fit entre ces œuvres et la ou les culture-s populaire-s régionale-s(minière, côtière, rurale)? 2 – Les mutations des années 1980 et 90. En aval du constat de la profonde crise économique et sociale qu’a connue la région, on observe que des changements non moins profonds se sont opérés dans la mise en œuvre des politiques publiques de la Culture durant cette période. On prendra pour illustrer cette proposition un exemple anecdotique entre tous, mais qui semble emblématique: la «mise sur la touche» de Cyril Robichez par Jack Lang, au profit de Jean-Louis Martin Barbaz, n’est en effet pas seulement le signe d’une volonté de changement générationnel. Quels acteurs institutionnels et culturels nouveaux se sont donc manifestés à ce moment-là? Quelle réflexion politique, quels enjeux ont porté l’émergence de projets nouveaux? À côté du diagnostic porté sur les conséquences de la fermeture des mines, qu’est- ce qui, dans les politiques publiques antérieures, n’existait pas – ou a été jugé caduque – qui a rendu cette émergence nécessaire? Enfin, quels changements dans les pratiques artistiques elles-mêmes ont présidé à un renouvellement des concepts ou des équilibres dans le travail respectifs des artistes, des tutelles locales ou nationales, des acteurs associatifs ou sociaux? 3 – Que peut on dire des évolutions récentes et de la situation actuelle? Peut-on confronter les réflexions émanant directement des études sur les politiques culturelles, et celles concernant d’autres champs des politiques publiques (l’aménagement du territoire par exemple?). À l’heure du tout libéral, des baisses de dotation aux collectivités, du désengagement de l’état, que peut-on dire et attendre de pratiques nouvelles - ou renouvelées – telles que l’émergence de projets en milieu rural, ou de projets culturels participatifs? Ces trois séries de questions pourront structurer plusieurs événements de recherche successifs, dont la vocation est de constituer autant d’étapes d’une étude «au long cours» sur ces liens entre arts, politique, publics, et éducation populaire, d’hier à aujourd’hui. Une double démarche commune unifie ces différents événements: celle d’éclairer les pratiques présentes par l’analyse de celles d’un passé dont on sent, à tous égards, à la fois l’empreinte et l’absence; et celle de ne jamais dissocier réflexion sur les formes artistiques et réflexion politique, choix esthétiques et contextes idéologiques, au sens large du terme. Dans cette mesure, cette étude concerne au premier chef les spécialistes d’arts de la scène et du spectacle vivant, mais s’ouvre naturellement à d’autres disciplines, en particulier la sociologie de la culture, ou les sciences politiques. Un premier colloque, organisé les mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2019 à l’Université d’Artois, sera consacré à la première de ces trois directions de travail: une étude des acteurs régionaux «historiques» de la décentalisation, de 1945 à 1991. D’autres journées – dont le calendrier, en amont ou en aval de ce colloque, sera établi prochainement –, porteront sur la période plus récente, et sur d’autres thématiques associées à cette réflexion générale . COMMUNICATIONS Comité d’Organisation:Françoise Heulot-Petit, Pierre Longuenesse, Pierre Rogez Les propositions de communication pour ce premier colloque (titre, résumé d’une dizaine de lignes, CV de quelques lignes) sont à envoyer avant le 15 octobre 2018 aux co-organisateurs: Françoise Heulot-Petit ( francoise.heulotpetit@gmail.com ), Pierre Longuenesse ( pierre.longuenesse@wanadoo.fr ) Comité scientifique: Aude Astier, MCF, Arts du spectacle, université Marc Bloch – Strasbourg -Myriam Bachir, MCF HDR, Sciences Politiques, université de Picardie Jules Verne – Amiens -Serge Chaumier, PR, Expo-muséographie, université d’Artois -Marion Denizot, PR, Arts du spectacle, université de Rennes-II -Françoise Heulot-Petit, MCF, Arts du spectacle université d’Artois, Arras -Pierre Longuenesse, MCF HDR, Arts du spectacle, université d’Artois, Arras -Muriel Plana, PR, Arts du spectacle, université Toulouse II-Jean Jaurès -Frédéric Poulard, MCF, Sociologie, université Lille I Repères bibliographiques: - ABIRACHED Robert (dir.), La décentralisation théâtrale , Tome 1, «Le premier âge» 1945-1958, Arles, Actes Sud, 1992. Tome 2, «Les années Malraux» 1959-1968, Arles, Actes Sud, 1993. Tome 3, «1968, Le tournant», Arles, Actes Sud, 1994 (re-ed. 2005). Tome 4, «Le temps des incertitudes» 1969-1981, Arles, Actes Sud, 1995 (ensemble ré-édité en 2005) - ABIRACHED Robert, Le Théâtre et le prince , t. 1 et 2, Arles, Actes Sud, 2005 - DENIZOT Marion, Jeanne Laurent. Une fondatrice du service public pour la culture . 1946-1952 , préface de Robert Abirached, Comité d’histoire du ministère de la Culture, La Documentation française, 2005 - GIGNOUX Hubert, Histoire d’une famille théâtrale , ANRAT / L’Aire théâtrale, 1984 - GOETSCHEL Pascale, Renouveau et décentralisation du théâtre (1945–1981) , Paris, PUF, 2000 - HAMIDI-KIM Bérénice, Les Cités du théâtre politique en France depuis 1989, préface de Luc Boltanski, Lavérune, L’Entretemps, 2013 - LEPAGE Franck (études réunies par), Education populaire, une utopie d’avenir, éditions LLL, Cassandre/Hors Champ, 2012 - LONCLE Stéphanie (dir.) Théâtre/Public , mars 2013, n°207 «Théâtre et néo-libéralisme» - LOYER Emmanuelle, Le Théâtre citoyen de Jean Vilar. Une utopie d’après-guerre , Paris, PUF, 1997 - MEYER-PLANTUREUX Chantal, Théâtre populaire, enjeux politiques , Bruxelles, Complexe, 2006 - PLANA Muriel, Théâtre et Politique , t. 1 et 2, Paris, Orizons, 2014 - Ouvrage collectif, Théâtre et jeunes spectateurs: pour un nouveau théâtre populaire, Lyon, Les Cahiers du soleil debout , 1976. - Revue La scène , supplément au n° 21, Juin 2001, colloque « Les politiques culturelles pour l’enfance et la jeunesse ».
↧
Colloque : "La Décentralisation théâtrale dans la Région Hauts-de-France -Premier volet: les acteurs «historiques» - 1945-1991" (Artois)
↧
Colloque : "Le sens des formes dans l’Europe d’Ancien Régime : expressions et instruments du politique." (Paris)
Colloque : "Le sens des formes dans l’Europe d’Ancien Régime : expressions et instruments du politique." (Paris) Jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 Université Paris-Est Créteil / Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 PRESENTATION Les arts d’Ancien Régime étaient souvent des arts de circonstance, au discours contraint, sans que ce constat doive entraîner un quelconque jugement de valeur esthétique, en ce que ces arts prennent leur sens plein dans un contexte social dont le jeu politique n’est jamais complètement absent. À la cour en particulier, toute activité avait nécessairement un volet politique, jusqu’aux plus intimes – comme la nuit de noces célébrée devant témoins lors de certains mariages royaux. Il ne pouvait en aller autrement pour les pratiques artistiques auxquelles s’adonnaient autant les courtisans que les souverains, notamment la poésie, la musique et la danse : on pense aux ballets dansés par Louis XIV en France et aux masques donnés à grands frais à la cour d’Angleterre, mais aussi à l’importance accordée à ces trois pratiques dans Il Cortegiano de Castiglione, pour qui elles sont indispensables au gentilhomme. Le poète, le musicien, le danseur courtisans sont donc bien éloignés de l’image que le Romantisme nous a laissée de l’artiste bohème, maudit ou méconnu, rebelle aux conventions de la société bourgeoise et, contrairement à elle, sincère. Ce critère de sincérité, établi par un Jean-Jacques Rousseau qui opposait la langue du cœur à l’hypocrisie de la société, est devenu, et pour longtemps, le principe fondateur de l’expression artistique – reléguant par là-même toute œuvre composée pour répondre à des circonstances extérieures au rang de la médiocrité. C’est lui qui nous fait associer étroitement l’art à la sphère privée voire intime, et c’est souvent à son prisme que nous considérons les œuvres du passé, et en particulier celles de la Renaissance, au risque du contre-sens. Pourtant, de nombreux indices invitent à reconsidérer la littérature de la première modernité dans le cadre social et idéologique qui était le sien et à aborder les choix esthétiques non plus seulement comme l’expression de préférences personnelles mais également comme celle d’un projet lié au groupe auquel le poète se rattache, et donc à les analyser dans un contexte qui prend en compte, par exemple, les rapports de force entre différentes factions courtisanes. En dehors de la cour, d’autres pratiques artistiques sont tout aussi étroitement liées à l’action politique : on pense bien entendu aux campagnes de libelles et autres mazarinades, mais aussi à l’emblématique ou à la poésie spirituelle, en particulier lorsqu’un procès en canonisation est l’occasion d’affirmer la puissance d’un État, d’un lignage ou d’une ville – ainsi, des joutes poétiques en l’honneur de Thérèse d’Avila. Nous nous proposons donc d’examiner le lien entre le politique et les arts en prêtant une attention redoublée au contexte d’énonciation ou de performance des œuvres, afin de faire apparaître la dimension politique des choix esthétiques même en l’absence de contenus explicitement politiques. Plus précisément, nous nous intéresserons à la façon dont les formes elles-mêmes, qu’elles soient linguistiques, génériques, métriques, matérielles, visuelles ou sonores, expriment le politique, dans toute sa complexité – puisque même les formes destinées à la flatterie peuvent instiller le conseil, la critique, ou la négociation subtile de rapports de pouvoir. Ce colloque pourrait être enfin l’occasion d’interroger la notion même de forme dans les différents champs disciplinaires et selon les usages ou les contextes où elles sont observées. AXES DE RECHERCHE On pourra étudier, entre autres :les divertissements officiels, tels les ballets de cour, les “entrées” de personnages publics, les masques et cérémonies civiquesles genres littéraires, qu’ils soient évidemment liés au politique, comme le pamphlet, ou en semblent faussement détachés, comme la pastorale – et les milieux dans lesquels ces formes sont partagées ou débattuesles formes métriques, qui font parfois référence à des cultures concurrentes (renvoi à un idéal classique ou à la culture vernaculaire d’un pays voisin) et impliquent un jeu d’influence, de rivalité ou d’émulation dans la construction des identités nationales ou de l’identité d’un groupe par rapport à un autreles paratextes, qui tâchent de négocier la réception d’une œuvre à travers une série de dédicaces à des personnages importants, épîtres au lecteur, et poèmes à la louange de l’auteur rédigés par ses collègues et amis – et parfois articulent avec difficulté ces pièces d’occasion qui peuvent s’avérer politiquement contradictoiresles supports matériels choisis pour la diffusion de tel ou tel texte, comme le format de publication, la mise en page ou la fonte, l’histoire du livre et la material culture étant deux disciplines qui s’attachent depuis longtemps aux “sens des formes” dans ce que celles-ci ont de plus concretCe colloque réunira des spécialistes de l’Europe et de ses possessions extra-européennes du 15e au 18e siècle, dans une perspective comparatiste et résolument interdisciplinaire. Conférence plénière Nigel SMITH (Princeton University) Comité scientifique Mercedes BLANCO (Sorbonne Université), Fernando BOUZA (Universidad Complutense Madrid), Paloma BRAVO (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), Camilla CAVICCHI (Centre d'Études Supérieures de la Renaissance), Charlotte COFFIN (Université Paris-Est Créteil), Line COTTEGNIES (Sorbonne Université), Séverine DELAHAYE-GRÉLOIS (Université Paris-Est Créteil), Jean-Louis FOURNEL (Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis / Institut Universitaire de France), Sagrario LÓPEZ POZA (Universidad de La Coruña), Karen NEWMAN (Brown University), Bruno PETEY-GIRARD (Université Paris-Est Créteil), Matteo RESIDORI (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3), Elisabeth ROTHMUND (Université Paris-Est Créteil), Jessica WOLFE (University of North Carolina at Chapel Hill). Comité d’organisation Paloma BRAVO (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CRES-LECEMO), Charlotte COFFIN (Université Paris-Est Créteil, TIES-IMAGER), Séverine DELAHAYE-GRÉLOIS (Université Paris-Est Créteil, CREER-IMAGER). Ce colloque est une collaboration des équipes IMAGER (Institut des Mondes Anglophone, Germanique et Roman) et CRES- LECEMO (Centre de Recherche sur l’Espagne des XVIe et XVIIe Siècles - Les Cultures de l’Europe Méditerranéenne Occidentale). CONTRIBUTIONS Les propositions (titre, résumé de 300 mots et notice biographique de 150 mots) sont à envoyer avant le 15 septembre 2018 à : lesensdesformes@gmail.com
↧
↧
Colloque : "La littérature maghrébine d’impression française" (Tunisie)
La littérature maghrébine d’impression française Congrès international organisé par le Laboratoire de Recherches: Études Maghrébines, Francophones, Comparées et Médiation Culturelle 6-8 décembre 2018 : Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba (Tunisie) PRESENTATION Dans un ouvrage collectif, consacré à la valeur de l’œuvre littéraire, entre pôle artistique et pôle esthétique, Habib Ben Salha a introduit une nouvelle dénomination littéraire: la littérature maghrébine d’impression française (1). Pour réhabiliter un mot mal reçu, mal lu, le critique développe sa réflexion à partir de deux définitions du terme: «Impression 1: action de mettre une empreinte. 2. Du Lat philosophique impressio : Impression sur les sens» (2). Il s’agit de présenter une approche nouvelle de l’identité et de la différence, de la langue, des rives, des genres, de l’extrême, de la parole… . Tout cela à travers une autre lecture de l’instant dans une société en mutation. Comment rendre l’éphémère, écrire le fugace, suivre la variation, retracer la teinte, traduire les reflets changeants du global sur le local. Ce qui s’offre à nos yeux dépasse l’entendement. Les Littératures maghrébines de l’expression avec ou sans retour du référent ont-elles fait leur temps? Le Maghreb est un brasier vivant: l’impression semble l’avenir de l’expression. C’est que, à la source d’une langue, il n’y a pas une seule langue, mais un mélange extraordinaire de racines, de codes, de modes, de mutations, de transmutations. Les mots voyagent, les énoncés s’opposent, s’équilibrent ; restent l’envie d’énoncer et à chaque énoncé une énonciation nouvelle. À l’instant où nous introduisons notre réflexion sur une littérature qui a trop de noms, trop de pères, trop d’équations, trop de clichés, trop de « clicheurs » : littérature maghrébine d’expression française, de graphie, de langue française, littérature arabe écrite en français… des verbes vibrent, perdent leurs phonèmes, des adjectifs se métamorphosent, se réveillent méconnaissables, et ce n’est pas de leur faute. Jamais une seule racine, un seul son, une appellation n’égalent la mobilité des lieux, la densité et la complexité de traditions et de changements, l’étrangeté des forces permanentes qui agissent sur les écrivains, le laboratoire de l’existence et le mouvement des idées qui pèsent sur eux et qui les infléchissent vers telle ou telle route. Où va-t-on ? Les écrivains maghrébins ne deviennent si grands que lorsqu’ils décident de ne plus faire du maghrébin sur commande, quand ils interrompent le cycle « de la coquille évidée : je suis – qui suis-je ? Ceci contre cela, ceci et/ou cela », pour écrire, rêver, advenir. L’écrivain libéré des impératifs de la couleur locale, du piège des lieux communs, du dogmatisme des écoles parisiennes (aux -ismes têtus), de l’arrogance des collèges américains (aux affixes figés : pré- post-) redécouvre la joie du divers, le plaisir de l’exil heureux (3), l’envie des variations musicales. Cette littérature part de l’interface linguistique, se nourrit des signes de la modernité et s’offre à lire comme «un palimpseste vivant où une sorte de traduction intérieure invente des langues dans la langue » (4). C’est ainsi qu’elle tient tête aux discours aliénants de l’universel, sème les autoroutes de la globalisation, (re)crée le monde à partir des archè du territoire millénaire où elle ne cesse de renaître. L’écriture des imaginaires qui président à ces textes doit, aujourd’hui, arracher les tablettes de notre histoire des mains de «l’hypersauvage suréquipé» ( cf Georges Balandier) qui en monopolise les formulations. C’est que les littératures maghrébines n’ont jamais été considérées comme l’espace d’une réflexion dans une société en mutation. On aura essayé toutes les clés possibles. On a bien-cherché du côté de l’auteur maghrébin: critique socio-historique, psycho-critique, thématique. Déjeux lecteur de J. Amrouche, de Memmi et de bien d’autres classiques. Il s’est contenté d’analyser l’homme qui s’exprime dans le livre, en regroupant les traces de sa présence et en rejetant ²certaines théories (ou sur-théories)² (5). Les horizons ouverts par cette écriture nouvelle du monde envisagent la profondeur, sauvage, de l’humain comme socle incontournable du texte, d’où l’incitation d’Octavio Paz, à creuser en cherchant la littérature du fond, le fruit littéraire qui traverse les temps et les espaces en refusant la cage de la langue, de la classe ou de la race: ²la littérature est en nous, à l’intérieur de nous. C’est aujourd’hui et c’est la plus lointaine antiquité. C’est demain et c’est l’aube du monde: elle a mille ans et elle vient juste de naître² (6). Pour s’affirmer en tant qu’impression originale de ce monde nouveau la littérature maghrébine doit oser les apories de l’homme divers qu’elle (re)présente, donner corps à l’informulé, créer les paradigmes de cet impensé occulté par les colons du passé et diabolisé par les stratèges de la mondialisation. Et elle ne pourra le faire qu’en variant les paradigmes et en dépassant ce que Todorov appelle la seule expression de la nationalité des écrivains: «ce qui fascine, excite, enthousiasme est une sensation qu’à travers des œuvres diverses, foisonnantes, dérangeantes se dit le monde d’aujourd’hui, avec ses rythmes, son énergie, ses langages vrais. [..] Ecrire, créer ne revient pas à ²exprimer² une culture, mais à nous en arracher [..], à s’ouvrir au dialogue avec d’autres cultures. Le plus grand écrivain néerlandais vivant, de l’avis unanime est Marocain d’origine: Abdelkader Ben Ali² (7). Il est grand temps, aujourd’hui, de promouvoir une littérature maghrébine qui rende compte de ce tremblement des paradigmes et de cet échange avec les voix du monde. Cet art de la parole (s’)engage sur des voies qui aident à transfigurer les racines du texte et ses codes pour en faire les trames des ²formes de vie² qui y grouillent. Du fait même qu’elle condense les phrasés de l’existence et les modalités de la vie humaine, la littérature est inséparable du vivre, de l’agir, du pâtir. Les lectures (critiques) de cette littérature sont appelées à sonder ses interrogations éthiques et leurs croisements avec les enjeux esthétiques de l’œuvre. Comme l’écrivain maghrébin est un grand mangeur de livres et un déterreur de contes légendaires, nous chercherons les fragments de cette conscience erratique du texte dans les mouvements chaotiques de la lecture et de l’écriture. Du fait du pacte éthico-esthétique qui la fonde, la littérature dont nous parlons développe une autoréflexion sur les conditions de sa production et les horizons de sa réception. Il existe dans tout écrivain maghrébin un critique bien puissant. Nedjma , note Marc Gontard, marque un sommet dans la littérature maghrébine. Les marques spécifiques de cette grandeur littéraire proposent le texte comme une “peinture impressionniste” où d’autres syntaxes du monde nous dévoilent un charme divers du «lieu et [de] la formule» tant recherchés par le poète (8). NOTES 1-) La valeur de l’œuvre littéraire , Etudes réunies par P. Voisin, classiques Garnier, 2012, p. 19. 2-) Définitions proposées par le Dictionnaire étymologique de la langue française, PUF, 2002, p. 333. 3-) Voir Poétique maghrébine et Intertextualité , Publications de la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba, 1992. 4-) Op.cit , p. 516. 5-) J. Déjeux, Situation de la littérature maghrébine de langue française , Alger, Office des publications universitaires, 1982, p. 141. 6-) Octavio Paz, La Quête du présent , Gallimard, 1990, p. 33. 7-) T. Todorov, La littérature en péril , Flammarion, 2006, p. 38. 8-) C’est une résonance de la clausule du poème «Vagabonds» de Rimbaud ( Illuminations ): in Arthur Rimbaud , Œuvres complètes , édition établie, présentée et annotée par Antoine Adam, Paris, nrf, Gallimard, 1972, rééd., 2005, p. 137. AXES DE RECHERCHE Le Congrès international Littérature maghrébine d’impression française invite à ouvrir le champ de ces nouvelles écritures de l’homme (maghrébin). L’épanouissement d’une production littéraire capable d’être à l’écoute de ce tremblement des paradigmes maghrébins est inséparable de l’acte créatif qui ose défendre ses apories et les insérer dans les réseaux culturels et artistiques du XXIème siècle. Pour cela, nous comptons réunir les spécialistes qui travaillent sur ces créneaux afin de réfléchir, ensemble, sur les perspectives d’une «littérature maghrébine d’impression française» dont les conditions d’existence sont, aujourd’hui, réunies. Cet immense chantier envisage d’innombrables points de vue et diverses thèses de travail. Les axes proposés, ci-dessous, ne doivent donc pas limiter les horizons de cette réflexion que nous voudrions ouverte, plurielle et transdisciplinaire. 1-) Littérature maghrébine d’impression française, un laboratoire de(s) nouvelles formes d’écriture. 2-) La littérature maghrébine d’impression française : une écriture qui arpente le monde. 3-) La Littérature maghrébine d’impression française: pour un renouvellement des frontières du moi. 4-) Littérature maghrébine d’impression française et dynamiques relationnelles. 5-) La littérature maghrébine d’impression française, un outil d’exploration des catégories du possible. 6-) La littérature maghrébine d’impression française, pour répondre aux horizons d’attente des lecteurs du XXIème siècle. 7-) Quelle critique pour la littérature maghrébine d’impression française? 8-) De la littérature maghrébine d’impression française comme réponse à la séparation entre la parole créatrice et les arts. 9-) La littérature maghrébine d’impression française: reflet des dynamiques sociales et des aspirations démocratiques du XXIème siècle. COMMUNICATIONS Les propositions de communication doivent être envoyées avant le 25 octobre 2018 par voie électronique à l’adresse: adelbensh@yahoo.fr Les réponses du comité scientifique seront communiquées le 30 octobre 2018. Les frais de participation sont de100 Euros (qui incluent le logement, les repas et la publication des Actes du Congrès). Comité scientifique Habib Ben Salha, Université de Manouba / Labolima - Tunisie Hamdi Hemaidi, Université de Manouba / Labolima - Tunisie Mohamed Mansouri,Université de Manouba / Labolima - Tunisie Adel Khidr,Université de Manouba / Labolima – Tunisie Abbes Ben Mahjouba, Université de Manouba / Labolima – Tunisie Sadok Bouhlila,Université de Manouba / Labolima - Tunisie Ahmed Somai, Université de Manouba / Labolima - Tunisie, Néjib Ben Jemai,Université de Manouba / Labolima – Tunisie Patrick Voisin, Laboratoire Babel(EA 2649) - France / Labolima – Tunisie Abdedelouahed Mabrour,Laboratoire d’Etudes et de recherche sur l’interculturel,Université Chouaib Doukkali, Eljadida, Maroc Sana Gouati,Université de Kénitra, Maroc Mohamed Bernoussi,Université de Meknès, Maroc Françoise Argod-Dutard, Les Lyriades - France Bertrand Sajaloli, Université d’Orléans - France Christine Jacquet Pfau, Collège de France Paris - France Jean-François Sablayrolles, Université de Paris X Henriette Walter, Université de Haute-Bretagne - France Simona Modreanu, Université Alexandru Ion Cuza Iasi - Roumanie Karima Yatribi, Université Mohammed v , Rabat - Maroc Aicha Fadil, Université Hassan 1 er Settat - Maroc Abderrahmen Tenkoul, Université de Kénitra, - Maroc Rachid Hamdi, Université de Guelma - Algérie Amel Maafa, Université de Guelma – Algérie Comité d’organisation Habib Ben Salha Bessem Aloui Wafa Bsaies-Ourari Abbes Ben Mahjouba Anissa Kaouel Mhamed Sayadi Adel Habbassi Hanène Harrazi Ksontini Issam Maachaoui Ilhem Saïda Ibtihel Ben Ahmed Faycel Ltifi R esponsable Habib Ben Salha
↧
Revue Non Plus , n°14. (Thème Libre) [FR/POR]
Revue Non Plus , n. 14. (Thème Libre) PRESENTATION Revue Non Plus est une publication électronique semestrielle du programme de troisième cycle en Études Linguistiques, Littéraires et Traductologiques en Français, de la Chaire de Lettres Modernes de la Faculté de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines (FFLCH) de l'Université de São Paulo (USP). Les articles doivent avoir des bases théoriques dans les domaines des Études et de la Critique de la Traduction et de la Didactique, liés à la langue française et aux cultures francophone obligatoirement . La Revue accepte aussi la soumission de traductions de textes dans le domaine public relatifs aux thématiques traitées par la revue (justifiées par une introduction critique); notes de lecture de livres, thèses et mémoires (dans le cas de notes de lecture de thèses et/ou mémoires, l'auteur doit avoir participé de la soutenance); et des rapports d'expérience didactique, insérés dans une activité de recherche scientifique et dans le contexte de l'enseignement de la langue ou de la littérature française et/ou francophone. Dans l'esprit d'encourager le dialogue entre les différents acteurs de la vie académique, nous acceptons la soumission d'articles d'étudiants du deuxième et du troisième cycles, de professeurs et de chercheurs. Les travaux des étudiants à la licence devront avoir un docteur comme coauteur. CONTRIBUTIONS Pour le numéro 14, les articles doivent être soumis jusqu'au 30 AOÛT 2018 à travers le site (http://www.revistas.usp.br/nonplus (Il faut s'inscrire comme auteur). La publication prévue du numéro est décembre 2018. Nous rappelons que les auteurs doivent observer attentivement les normes de publication disponibles sur le site: http://www.revistas.usp.br/nonplus/about ___________________________ Chamada para publicação Revista Non Plus , n. 14. (Tema Livre) Caros pesquisadores, Temos o prazer de convidá-los a submeter trabalhos para o número 14 da Revista Non Plus (ISSN: 2316-3976), publicação eletrônica semestral do programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em Francês, do Departamento de Letras Modernas, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), da Universidade de São Paulo (USP), Qualis B3 (Letras e Linguística) e B5 (Psicologia). Serão aceitos para submissão artigos de temática livre e caráter teórico que contemplem os segmentos de Didática, Estudos Literários, Crítica Literária, Língua Francesa e Tradução, relativos à língua francesa e às culturas francófonas (Textos que não cumprirem essa exigência serão recusados). A Revista também aceita a submissão de traduções de textos em domínio público relativos às áreas abordadas pela revista (devidamente embasadas por aparato crítico); resenhas de livros, teses e dissertações (no caso de resenhas de teses e dissertações, o autor, preferencialmente, deve ter participado da banca de defesa ou qualificação); e ainda relatos de experiência didática, contanto que estejam inseridos em uma atividade de pesquisa científica e no contexto do ensino de língua ou literatura francesa e/ou francófona. No intuito de fomentar o diálogo entre as várias etapas da vida acadêmica, aceitamos a submissão de artigos de alunos de pós-graduação, de professores e demais pesquisadores. Trabalhos de alunos de graduação também são aceitos, desde que em coautoria com o orientador ou com pesquisador com título de doutor. Para o número 14, os artigos devem ser enviados até 30 DE AGOSTO DE 2018 , sempre através do endereço: http://www.revistas.usp.br/nonplus (É necessário cadastrar-se como autor. Pedimos que todos os campos sejam preenchidos). O número tem publicação prevista para Dezembro de 2018. Lembramos ainda que os autores devem observar as normas de publicação disponíveis no endereço: http://www.revistas.usp.br/nonplus/about São aceitos trabalhos redigidos em português ou francês. Contamos com a ajuda de todos na divulgação dessa chamada. Aproveitamos para convidá-los a apreciar os números anteriores da revista, no endereço:http://www.revistas.usp.br/nonplus/issue/current. E a “curtir” nossa página no Facebook®:https://www.facebook.com/nonplus.revista
↧
Colloque : "L’indiscipline dramaturgique. Territoires de la dramaturgie." (ENS Lyon)
Colloque:L’indiscipline dramaturgique. Territoires de la dramaturgie. 25-27 mars 2019. ENS Lyon PRESENTATION «On m’appelle le dramaturge, mais je ne sais pas vraiment ce que je suis, ni si les autres dramaturges font le même métier que moi». Voici comment Joseph Danan ne définit pas, dans Qu’est-ce que le théâtre? (Biet et Triau) la figure du dramaturge. C’est là une difficulté récurrente : les contours d’une telle fonction ne se laissent pas facilement identifier. La liste est longue qui vise d’ailleurs à la définir: tour à tour conseiller littéraire ou artistique (M. Bataillon), «grosse oreille» (M. Stuart), «œil extérieur», estomac, chercheur, «homme des notes de bas de page» (J. Danan), traducteur, passeur, confident, répétiteur, «flic du sens» (A. Vitez). N ombreuses sont également les tentatives qui tentent de décrire le «travail» ou la «démarche» plus que le dramaturge, voire cherchent à identifier, tel Bernard Dort, l’«état d’esprit dramaturgique», formule qui permet d’éviter toute cristallisation sur une personne et sur un type d’activité. Ce colloque entend moins s’interroger sur l’identité du dramaturge ou les contours de son activité, que sur les formes et les modalités que prend ce travail. Jean Jourdheuil a proposé la métaphore du cambriolage. Il s’agit de prendre cette hypothèse au sérieux. Et si ce «roi sans pays» (C. Marthaler) était en fait de tous les territoires? La question est bien celle de «l’indiscipline», de la façon dont la dramaturgie mobilise, convoque, traverse, emprunte, mêle, colle des champs disciplinaires distincts — du champ de l’art à celui des sciences humaines et des sciences exactes. L’indiscipline se distingue tout autant d’une perspective pluri-disciplinaire qui superposerait des savoirs, comme autant de cautions scientifiques ou érudites pour le spectacle à venir, que d’une démarche inter-disciplinaire, tant la scène conditionne et aimante toute autre discipline. Aborder la dramaturgie comme geste indiscipliné n’a pas pour objectif de la parer d’une quelconque subversion systématique ni, par ailleurs, d’opposer à la «rigueur» des un.es la désinvolture des spécialistes de tout, encore qu’il faille s’interroger sur ce qui différencie l’indiscipliné de l’amateur et de l’érudit. Il s’agit par cette proposition de tenter de rendre compte de la singularité d’une pratique déterminée par l’horizon scénique (ses nécessités et ses particularités), organiquement liée à un processus de création. En quelque sorte : interroger moins la place du dramaturge que la façon dont chacun.e travaille et le type de « savoir » singulier qui les mobilise concrètement et les justifie. Le colloque qui rassemblera praticiens et théoriciens a pour dessein d’explorer cette hypothèse, de l’amender, de la construire. Il prendra pour objet des expériences concrètes de travail dramaturgique, rapportées par celles et ceux qui les ont menées, ou étudiées suivant des angles esthétiques, historiques, politiques, épistémologiques par des chercheur.es. Seront privilégiées les expériences qui convoquent notamment des champs disciplinaires distincts de celui des arts de la scène, afin de déterminer les apports singuliers provoqués par ces emprunts — tout autant que leurs éventuels dangers ou limites. Qu’en est-il des rapports entre savoir(s), connaissance(s), épistémologie et création théâtrale? Comment penser l’«impropre» de la démarche dramaturgique et les enjeux qui le sous-tendent? Il s’agira en outre de repérer dans quelle mesure et selon quel mode spécifique les outils méthodologiques d’un champ peuvent s’adapter à la scène. AXES DE RECHERCHE Les questionnements suivants pourront guider les propositions d’interventions:Historicité de l’indiscipline. «L’indiscipline» dramaturgique a-t-elle suscité ou nourrit-elle des réserves ou des objections? Peut-on repérer des suprématies ou des hégémonies disciplinaires à certaines périodes de l’histoire de la dramaturgie? Quelles en furent les conséquences pour les œuvres et pour la pratique dramaturgique elle-même ? Et comment envisager ou caractériser, en regard, notre présent ?Actualité de l’indiscipline. Les formes contemporaines que prend la dramaturgie ont-elles recours à de nouveaux champs disciplinaires, ou des études ( studies ) d’objets auparavant ignorés? La réception dramaturgique des œuvres contemporaines (leur analyse), nécessite-t-elle le recours à des champs disciplinaires nouveaux? La notion d’«indiscipline» est-elle adéquate aux pratiques dramaturgiques contemporaine?(Se) former à l’indiscipline. Comment transmettre l’indiscipline? Quelles en seraient les préventions éthiques, politiques voire scientifiques? L’indiscipline dramaturgique a-t-elle des incidences sur la constitution du champ des études théâtrales? Responsables : Olivier Neveux et Anne Pellois (IHRIM – UMR5317 – Ens de Lyon) COMMUNICATIONS Les propositions de communication sont à envoyer avant le 1er octobre 2018 à olivier.neveux@ens-lyon.fr et anne.pellois@ens-lyon.fr 300 mots max. Elles doivent être accompagnées d’une présentation succincte de l’auteur. Comité scientifique Leïla Adham, Université de Poitiers CatherineAilloud-Nicolas, Université Lyon 1 Anne-Françoise Benhamou, Ens Marion Boudier, Université d’Amiens Enzo Cormann, Ensatt Joseph Danan, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 Sylvain Diaz, Université de Strasbourg Mireille Losco-Lena, Ensatt Olivier Neveux, Ens de Lyon Anne Pellois, Ens de Lyon Julie Sermon, Université Lyon 2 Christophe Triau, Université Paris Ouest - Nanterre
↧
↧
Colloque : "Les expressions figées : Analyse linguistique et littéraire et exploitation en classe de FLE" (Algérie)
Colloque : "Les expressions figées : Analyse linguistique et littéraire et exploitation en classe de FLE" Colloque organisépar la Faculté des Lettres et des Langues, le Laboratoire LAILEMM et le Département de français 25 - 26 novembre 2018 PRESENTATION Complètement occultées et passées sous silence pendant longtemps, ou bien reléguées au second plan, les expressions figées ont actuellement le vent en poupe en didactique des langues, en sciences du langage et même en littérature. Cependant, en dépit de la pléthore de travaux et de colloques consacrés à cette question, notamment au cours de ces deux dernières décennies, il faut dire que les multiples essais de définition des expressions figées sont restés figés. La boutade de R. Martin (1997), vieille d’une vingtaine d’années, reprise par Béatrice Lamiroy (2008), reste toujours d’actualité : « Nous sommes nombreux à trouver que c’est un thème admirable, sans savoir avec netteté ce que c’est » . Selon Gross (1996: 154), les expressions figées sont caractérisées par un figement sur le plan syntaxique ou sémantique. «une séquence est figée du point de vue syntaxique quand elle refuse toutes les possibilités combinatoires ou transformationnelles qui caractérisent habituellement une suite de ce type. Elle est figée sémantiquement quand le sens est opaque ou non compositionnel, c'est-à-dire quand il ne peut pas être déduit du sens des éléments composants» (ibid.) . A la majorité des études sur le figement, sont associés les termes suivants: expressions idiomatiques, idiotismes, collocations, locutions, proverbes, gallicismes, phrasèmes, etc. Dans le domaine des sciences du langage, «il est incontestable qu’actuellement le figement est devenu une dimension fondamentale dans la description des langues» (Mejri, 2005). Cette importance trouve sans doute son explication dans le fait que, dans la langue, les unités polylexicales dépassent très largement les unités monolexicales (Gross, 1988). Dans le domaine de la didactique des langues, c’est la publication du Cadre européen commun de référence pour les langues qui leur permet de se frayer une place dans les pratiques de classe et qui leur donne un souffle nouveau. En littérature, elles sont considérées depuis longtemps comme banales et révèlent l’absence de créativité qui ne fait pas bon ménage avec la littérature qui se doit d’être inventive, novatrice. « Pourtant, la réalité a démenti en partie cela, car si l’on regarde de près la prose littéraire, on se rend compte que les expressions idiomatiques ne sont pas que l’apanage de la littérature de second ordre, mais que la littérature de tout genre fait un usage régulier et important de ces clichés linguistiques » (Capra, 2010). L’utilisation des expressions figées dans le texte littéraire n’est pas sans effets sur son esthétique, puisqu’elles peuvent rendre compte d’une valeur ajoutée à travers les sonorités et la prosodie caractéristiques de ces mêmes expressions. En outre, l’étude de la réappropriation des expressions figées par le texte littéraire nous renvoie inévitablement à examiner les notions d’intertextualité et d’interculturalité. Leur inscription dans le texte littéraire permet de le mettre en écho avec d’autres univers: culturels, sociaux, littéraires, etc. Dans le cas des expressions idiomatiques, étant donné qu’elles sont intimement liées à la culture d’un pays et que leur signification ne découle pas de l’agencement des mots qui les composent, elles font écran à la compréhension. "La méconnaissance du sens d'une expression provoque une rupture dans la cohérence du discours, et de ce fait, un trou d'information dans la procédure de la communication" (González Rey, 1995: 157). De ce fait, un apprenant non natif doit connaître ces expressions et les utiliser à bon escient pour réussir sa communication. Les proverbes également peuvent constituer une barrière à la compréhension même aux apprenants natifs d’une langue, d’autant plus que le proverbe est produit dans un contexte et un temps déterminés et révolus. AXES DE RECHERCHE Ce colloque tentera de mettre en évidence la part du lion qu’occupe l’analyse des expressions figées dans l’analyse du discours et l’importance qu’elles revêtent dans l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère. Ainsi, les thèmes suivants seront abordés(la liste n’est pas exhaustive) :La description syntaxique et sémantique des expressions figéesLa définition des limites entre les proverbes, les expressions idiomatiques, les collocations, etc.Les degrés de figement et le défigementLa didactisation des expressions figéesLes expressions figées et le développement de la compétence interculturelleLa traduction des expressions figéesL’insertion des expressions figées dans le discours littéraireL’insertion des expressions figées dans les autres discours COMMUNICATIONS Langue du colloque : français Date limite d’envoi des propositions : 06 septembre 2018 Date d’envoi des notifications aux auteurs : 30 septembre 2018 NB.La proposition devra être envoyée conjointement aux deux adresses suivantes: aammouden@yahoo.fr et belhocinemounya@yahoo.fr . Elle comportera le nom de l’auteur et son affiliation, un titre, un résumé de 300 mots maximum, 4 à 5 mots-clés, une bibliographie sommaire et une biographie succincte (moins d’une dizaine de lignes). Page du colloque: http://www.univ-bejaia.dz/presentation-cnef Présidents du colloque Dr. AMMOUDEN Amar Dr. BELHOCINE Mounya Comité scientifique Pr. AMOKRANE Saliha – Alger 2 Pr. AREZKI Abdenour–Bejaia Pr. BENHOUHOU Nabila – Alger 2 Pr. BOUALILI Ahmed – Tizi-Ouzou Pr. MEKSEM Zahir – Bejaia Pr. OUTALEB - PELLE Aldjia – Tizi-Ouzou Dr. ACI Ouardia – Blida 2 Dr. AIT CHALAL Md Salah – Tizi-Ouzou Dr. AMMOUDEN Amar – Bejaia Dr. AMMOUDEN M’hand – Bejaia Dr. BEKTACHE Mourad – Bejaia Dr. BELKACEM Dalila – Oran 2 Dr. LANSEUR Soufiane – Bejaia Dr. MENGUELLET Hakim – Blida 2 Dr. MOUALEK Kaci – Tizi-Ouzou Dr. SADI Nabil – Bejaia Dr. AIT MOULA Zakia – Bejaia Dr. AKIR Hania – Bejaia Dr. BELKACEM FODIL Hind - Mostaganem Dr. BELHOCINE Mounya – Bejaia Dr. BENAMER BELKACEM Fatima – Bejaia Dr. BOUCHOUCHA Myriam – Mila Dr. HADDAD Mohand – Bejaia Dr. LALILECHE Nadir – Bejaia Dr. MERZOUK Sabrina – Bejaia Dr. NASRI Zoulikha – Bejaia Dr. SLAHDJI Dalil – Bejaia Dr. ZOURANENE Tahar – Bejaia Comité d’organisation ABDELOUAHAB Fatah ADRAR Zahra AIT MOULA Zakia AMMOUDEN Amar AMMOUDEN M’hand BEDDAR Mohand BELHOCINE Mounya BENBELAID Lydia BENBERKANE Younes BENHAIMI Loubna BENNACER Mahmoud BESSAI Bachir BOURKANI Hakim CHERIFI Hamid DERRADJI Leila HADDAD Mohand HAMADACHE Tahar KACI Faiza MAKHLOUFI Nacima MEZIANE Khedoudja MOKHTARI Fizia OULD BENALI Naima OUYOUGOUT Samira SEGHIR Atmane SERIDJ Fouad SLAHDJI Dalil SIDANE Zahir TATAH Nabila TOUATI Radia YAHIA-CHERIF Rabia ZOURANÈNE Tahar Références bibliographiques ANSCOMBREJ.-Cl. (2003), «Les proverbes sont-ils des expressions figées?». DansMejri S. (éd.)Cahiers de lexicologie82, Paris, Champion, pp. 159-173. CAPRA Antonella, (2011), «Traduttore traditore: de la possibilité de traduire les expressions figées en littérature». Revue Interdisciplinaire "Textes & contextes"[en ligne], Numéro 5 (2010) : "Stéréotypes en langue et en discours". Url: https://revuesshs.u-bourgogne.fr/textes&contextes/document.php?id=1303&format=print#tocto7 GONZÁLEZ REY Maribel (1995). «Le rôle de la métaphore dans la formation des expressions idiomatiques». Dans Paremia, 4. GONZÁLEZ REY Isabel, (2002),La phraséologie du français, Toulouse,Presses Universitaires du Mirail. GROSS Maurice, (1988b), «Sur les phrases figées complexes du français», Langue française 77, pp.47-70. Url: https://www.persee.fr/docAsPDF/lfr_0023-8368_ 1988_ num_ 77_1_ 4737 .pdf KLEIBER Georges, (2010), «Proverbes : transparence et opacité», Meta, 55(1), 136–146. Doi : 10.7202/039608ar LAMIROY Béatrice, (2008), «Les expressions figées: à la recherche d’une définition». Dans Peter Blumenthal et Salah Mejri (ed.), Les expressions figées de la langue au discours, pp. 85-88. Url: http://wwwling.arts.kuleuven.be/franitalco/papers/Lamiroy2008.pdf MEJRI Salah, (2005), «Figement absolu ou relatif: la notion de degré de figement». Linx , 53, pp. 183-196. Url: http://journals.openedition.org/linx/283 MEJRI Salah, (2009), «Figement, défigement et traduction. Problématique théorique». Url: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00617431/document MEJRI Salah, (2013), «Figement et défigement: problématique théorique». Dans Pratiques , n°159-160,pp. 79-97.
↧
J. Ducos, C. Lucken (dir.), Richard de Fournival et les sciences au XIII e siècle
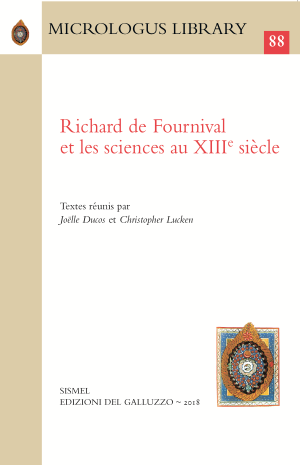 Richard de Fournival et les sciences au XIII e siècle Sous la direction deJoëlle Ducos et Christopher Lucken Micrologus Library, 88,2018 EAN : 9788884508430 pp. VI-444, € 68 PRESENTATION Chanoine et chancelier de la cathédrale d'Amiens, chirurgien et probablement médecin, auteur d'une autobiographie astrologique et peut-être d'un traité d'alchimie, possible auteur du De vetula qui se fait passer pour l'oeuvre ultime d'Ovide, poète et écrivain, Rihcard de Fournival apparaît comme l'une des figures les plus révélatrices de la culture encyclopédique du XIII e siècle. En témoigne tout particulièrement sa bibliothèque qu'il décrit dans la Biblonomia et qui apparaît comme un véritable synthèse des connaissances et des intérêts intellectuels de son temps. Réunissant les contributions de spécialistes des disciplines du quadrivium , ce volume se propose d'étudier les sciences telles quelles apparaissent dans les oeuvres et les entreprises de cet auteur majeur du XIII e siècle tout en l'inscrivant dans le contexte scientifique de son temps. TABLE DES MATIERES C. Lucken , Parcours et portrait d’un homme de savoir J.-M. Mandosio , La Biblionomia de Richard de Fournival et la classification des savoirs au XIIIe siècle I. Draelants , La Biblionomia de Richard de Fournival, une bibliothèque d’encyclopédiste? Enquête comparative sur les textes et les manuscrits M. Moyon , Arithmétiques et géométries au XIIIe siècle d’après la Biblionomia: des traductions arabo-latines à Jordanus de Nemore L. Miolo , Science des nombres, science des formes: arithmétique et géométrie dans les manuscrits de la Biblionomia de Richard de Fournival M. H. Green , Richard de Fournival and the Reconfiguration of Learned Medicine in the Mid-13th Century L. Moulinier-Brogi , Richard de Fournival, la Biblionomia et la science des urines M. Giese , Works on Horse Medicine in the Biblionomia of Richard de Fournival in the Context of the High Medieval Tradition A. Calvet , Le De arte alchemica (inc.: Dixit Arturus explicator huius operis) est-il une oeuvre authentique deRichard de Fournival? J.-P. Boudet - C. Lucken , In Search of an Astrological Identity Chart: Richard de Fournival’s Nativitas N. Weill-Parot , La Biblionomia de Richard de Fournival, le Speculum astronomiae et le secret Ch. Burnett , Richard de Fournival and the Speculum astronomiae M.-M. Huchet , Le quadrivium dans le De vetula attribué à Richard de Fournival C. Panti, An Astrological Path to Wisdom. Richard de Fournival, Roger Bacon and the Attribution of the Pseudo-Ovidian De vetula J. Ducos , Conclusion Indexes par C. Lucken . Lire un compte-rendu de cet ouvrage.
Richard de Fournival et les sciences au XIII e siècle Sous la direction deJoëlle Ducos et Christopher Lucken Micrologus Library, 88,2018 EAN : 9788884508430 pp. VI-444, € 68 PRESENTATION Chanoine et chancelier de la cathédrale d'Amiens, chirurgien et probablement médecin, auteur d'une autobiographie astrologique et peut-être d'un traité d'alchimie, possible auteur du De vetula qui se fait passer pour l'oeuvre ultime d'Ovide, poète et écrivain, Rihcard de Fournival apparaît comme l'une des figures les plus révélatrices de la culture encyclopédique du XIII e siècle. En témoigne tout particulièrement sa bibliothèque qu'il décrit dans la Biblonomia et qui apparaît comme un véritable synthèse des connaissances et des intérêts intellectuels de son temps. Réunissant les contributions de spécialistes des disciplines du quadrivium , ce volume se propose d'étudier les sciences telles quelles apparaissent dans les oeuvres et les entreprises de cet auteur majeur du XIII e siècle tout en l'inscrivant dans le contexte scientifique de son temps. TABLE DES MATIERES C. Lucken , Parcours et portrait d’un homme de savoir J.-M. Mandosio , La Biblionomia de Richard de Fournival et la classification des savoirs au XIIIe siècle I. Draelants , La Biblionomia de Richard de Fournival, une bibliothèque d’encyclopédiste? Enquête comparative sur les textes et les manuscrits M. Moyon , Arithmétiques et géométries au XIIIe siècle d’après la Biblionomia: des traductions arabo-latines à Jordanus de Nemore L. Miolo , Science des nombres, science des formes: arithmétique et géométrie dans les manuscrits de la Biblionomia de Richard de Fournival M. H. Green , Richard de Fournival and the Reconfiguration of Learned Medicine in the Mid-13th Century L. Moulinier-Brogi , Richard de Fournival, la Biblionomia et la science des urines M. Giese , Works on Horse Medicine in the Biblionomia of Richard de Fournival in the Context of the High Medieval Tradition A. Calvet , Le De arte alchemica (inc.: Dixit Arturus explicator huius operis) est-il une oeuvre authentique deRichard de Fournival? J.-P. Boudet - C. Lucken , In Search of an Astrological Identity Chart: Richard de Fournival’s Nativitas N. Weill-Parot , La Biblionomia de Richard de Fournival, le Speculum astronomiae et le secret Ch. Burnett , Richard de Fournival and the Speculum astronomiae M.-M. Huchet , Le quadrivium dans le De vetula attribué à Richard de Fournival C. Panti, An Astrological Path to Wisdom. Richard de Fournival, Roger Bacon and the Attribution of the Pseudo-Ovidian De vetula J. Ducos , Conclusion Indexes par C. Lucken . Lire un compte-rendu de cet ouvrage.
↧
Ligature , n°14 : Revue critique du livre d'artiste
Ligature , n°14 : Revue critique du livre d'artiste Ligature, n°14 (revue critique du livre d'artiste), Association LAAC (Livre d'artiste & art contemporain), juillet 2018. EAN13 : ISSN22700404. PRESENTATION Le livre d’artiste peut contenir en soi les documents génétiques. Il peut être en même temps une œuvre d’art et un ensemble de documents spécifiques (esquisses, brouillons) concernant cette œuvre d’art. Par ailleurs, il est aussi un résultat de diverses expériences créatives, ce qui ouvre un champ riche pour mener les études dans divers domaines : art plastique, écriture, typographie… Les livres d’artiste ont parfois comme sujet propre de montrer le chemin de création ce qui touche à une manière particulière la problématique du titre à l’égard de ses genèses . Deux thématiques principales - mots-valises et bestiaire , - sont appliquées à cette recherche menée au sein du Laboratoire du livre d’artiste (section «Genèse des formes») en 2015-2017. TABLE DES MATIERES AVANT-PROPOS Première rubrique: DISCOURS. «Trouver le titre pour un livre d’artiste» (dossier «Animaux-Valises», matériaux du colloque 2008, Institut des textes et manuscrits modernes, Paris). Deuxième rubrique: LIVRE. «Esse Zo[H]omoou Le nouveau bestiaire» (livre d’artiste par Serge Chamchinov, extrait), Laboratoire du livre d’artiste, section «Genèse des formes», 2015; «Fossile Komposittiere», poème visuel, traduction allemande par Anne Arc. Troisième rubrique: ALBUM. «Atlas des constellations. Cinq galaxies des Animaux célestes» (série des encres de Chine par S. Chamchinov). Quatrième rubrique: PROJET. «Friedrich Nietzsche,Ecce Homo. Ainsi parlait Zarathoustra. Also sprach Zarathustra (extrait), par Henri de l’Amous. Laboratoire du livre d’artiste, 2018. BIBLIOGRAPHIE - La Fabrique du titre. Nommer l’œuvre d’art (P.-M. de Biasi, dir.), CNRS Éditions, Paris 2012. - Marcel Duchamp, La Mariée mise à nu par ses célibataires, même ( Boite verte ), Édition Rrose Sélavy [Marcel Duchamp], [1934]. - François Da Ros, Généalogies, Montreuil-sous-Bois, Éditions «Anakatabase» [François Da Ros], [2007]. - Serge Chamchinov [Schamschinoff], Fossiles-Animaux-Valises [ Fossile Komposittiere ], Atelier Avalon, 2006. - Raoul Dufy & Guillaume Apollinaire, Bestiaire ou Cortège d’Orphée , Éditions Deplanche, 1911. - André Lhote & Paul Eluard, Les Animaux et leurs hommes . Les hommes et leurs animaux , Au sens pareil, 1920. - Serge Chamchinov, Esse Zo[H]omo ou Le nouveau bestiaire , LLA, 2015.
↧
Medieval Barthes (University College London)
Medieval Barthes: Call for Papers for a One-Day Conference IAS Common Ground, UCL, 26 March 2019 The aim of this one-day conference is to reflect in two different ways on the notion of a ‘Medieval Barthes’. On the one hand, we want to consider Barthes’s own engagement with medieval culture, in his reading of medieval authors and in his engagement with medieval styles of thought. On the other hand, we want to explore the uses of Barthes within medieval studies: what medievalists have learnt from Barthes; how Barthesian concepts have been adapted for different medieval contexts; how medievalists inflect and change the way we read Barthes’s texts. In this conference, we will bring medievalists and modernists together in a productive dialogue. This dialogue will centre on a figure who is constantly evolving thanks to the continued publication of seminar notes and lecture transcripts. In searching for a medieval Barthes, the conference will build on the discussion of Barthes in: Carolyn Dinshaw, Getting Medieval: Sexualities and Communities, Pre- and Postmodern (Durham, N.C., 1999); Bruce Holsinger, The Premodern Condition: Medievalism and the Making of Theory (Chicago, 2005); Virginie Greene, ‘What Happened to Medievalists after the Death of the Author?’, in idem (ed.), The Medieval Author in Medieval French Literature (New York, 2006). A consideration of the various medievalist threads across the whole of Barthes’s œuvre , including posthumously published material, remains a desideratum that this conference hopes to address. Topics might include, but are in no way limited to: Barthes and: medieval authors; the body; medievalist contemporaries; material culture; death; etymologies; history; Latinity; love, desire, pleasure and affect; monasticism; mysticism; queerness; sexuality; (pre-modern) subjectivity; reading and hermeneutical practice(s); rhetoric; (inter)textuality; the visual. The organisers would be delighted to receive proposals for 20-minute papers on any aspect of ‘Medieval Barthes’. Proposals, comprising an abstract of max. 200 words accompanied by a short biography, should be sent by 1 October 2018 via email to medievalbarthes@gmail.com . Organised by Jennifer Rushworth (Lecturer in French and Comparative Literature, UCL) and Francesca Southerden (Associate Professor of Medieval Italian, Somerville College, Oxford), with the generous support of the UCL Institute of Advanced Studies, the MHRA, and the Society for French Studies.
↧
↧
Bêtises. Un dossier réuni par P. Engel (en-attendant-nadeau.fr)
 Bêtises Sur en-attendant-nadeau.fr : un dossier spécial «bêtises» qui propose, en cinqlivraisons estivales (une par semaine à partir du 20 juillet et jusqu’à la rentrée), un voyage littéraire, philosophique, naturaliste et surréaliste sur ce mal étrange, qui peut être aussi un bien, voire même un bonbon. "Comme on l’a souvent remarqué, il y a quelque arrogance à traiter de la bêtise, parce que cela rompt la règle de bienséance qui voudrait qu’on se dise pas plus bête qu’un autre: même si nous traitons les autres de cons à longueur de journée, de quel droit le faisons-nous? Mais, comme on le verra dans ce hors-série, beaucoup d’auteurs adoptent la modestie, et confessent volontiers leur propre bêtise, voire la revendiquent. Traiter de la bêtise est également bête parce que banal, quasiment vulgaire, voire lassant: combien de livres, de revues, de numéros de magazines, y compris littéraires, n’en ont pas traité? La littérature, la philosophie, le théâtre, le cinéma, la peinture et la musique même, ne cessent d’en parler, de l’illustrer et de la représenter: Érasme, Molière, Pope, Swift, Voltaire, Jean-Paul, Baudelaire, Flaubert, Bloy, Valéry, Musil, Satie, Johnny Rotten, Jeff Koons… C’est un thème universel, un pont aux ânes, si l’on peut dire. Il y a des dizaines de livres sur la bêtise, et l’essai sur la bêtise est devenu un genre en soi, produisant au minimum plusieurs volumes par an, des bêtisiers et sottisiers, reprenant le thème érasmien de l’éloge de la bêtise, celui de la Dunciade , ou prétendant la regarder, comme le pion Le Bouillondans Les aventures du Petit Nicolas , «bien dans les yeux», pour nous mirer en elle. Bien que nous emboîtions de nombreux pas, nous avons essayé ici d’éviter de traiter de la bêtise sous des formes habituelles. Nous confessons donc une dose de snobisme (autre forme de bêtise). C’est pourquoi on ne trouvera pas, notamment, d’article sur Flaubert: il aurait été un peu bête de chercher à apporter du nouveau sur ce sujet. Mais nous n’avons pas non plus cherché à être originaux, car par définition sur ce sujet on ne peut pas l’être. On retrouve donc dans ce dossier quelques figures centrales de la littérature sur la bêtise, mais aussi quelques incursions dans des chemins de traverse: un voyage à Cambrai, des poèmes, des odes, des nouvelles. […]". — P. Engel Lire la suite sur en-attendant-nadeau.fr… SommaireEntretien avec Alain Rogerpar Pascal EngelLa bêtise artificiellepar Agnès DesartheNoms d’oiseauxpar Anne SimonLes parias nombreux de l’intelligencepar Julien ZanettaBêtes à croquerpar Claude Grimal
Bêtises Sur en-attendant-nadeau.fr : un dossier spécial «bêtises» qui propose, en cinqlivraisons estivales (une par semaine à partir du 20 juillet et jusqu’à la rentrée), un voyage littéraire, philosophique, naturaliste et surréaliste sur ce mal étrange, qui peut être aussi un bien, voire même un bonbon. "Comme on l’a souvent remarqué, il y a quelque arrogance à traiter de la bêtise, parce que cela rompt la règle de bienséance qui voudrait qu’on se dise pas plus bête qu’un autre: même si nous traitons les autres de cons à longueur de journée, de quel droit le faisons-nous? Mais, comme on le verra dans ce hors-série, beaucoup d’auteurs adoptent la modestie, et confessent volontiers leur propre bêtise, voire la revendiquent. Traiter de la bêtise est également bête parce que banal, quasiment vulgaire, voire lassant: combien de livres, de revues, de numéros de magazines, y compris littéraires, n’en ont pas traité? La littérature, la philosophie, le théâtre, le cinéma, la peinture et la musique même, ne cessent d’en parler, de l’illustrer et de la représenter: Érasme, Molière, Pope, Swift, Voltaire, Jean-Paul, Baudelaire, Flaubert, Bloy, Valéry, Musil, Satie, Johnny Rotten, Jeff Koons… C’est un thème universel, un pont aux ânes, si l’on peut dire. Il y a des dizaines de livres sur la bêtise, et l’essai sur la bêtise est devenu un genre en soi, produisant au minimum plusieurs volumes par an, des bêtisiers et sottisiers, reprenant le thème érasmien de l’éloge de la bêtise, celui de la Dunciade , ou prétendant la regarder, comme le pion Le Bouillondans Les aventures du Petit Nicolas , «bien dans les yeux», pour nous mirer en elle. Bien que nous emboîtions de nombreux pas, nous avons essayé ici d’éviter de traiter de la bêtise sous des formes habituelles. Nous confessons donc une dose de snobisme (autre forme de bêtise). C’est pourquoi on ne trouvera pas, notamment, d’article sur Flaubert: il aurait été un peu bête de chercher à apporter du nouveau sur ce sujet. Mais nous n’avons pas non plus cherché à être originaux, car par définition sur ce sujet on ne peut pas l’être. On retrouve donc dans ce dossier quelques figures centrales de la littérature sur la bêtise, mais aussi quelques incursions dans des chemins de traverse: un voyage à Cambrai, des poèmes, des odes, des nouvelles. […]". — P. Engel Lire la suite sur en-attendant-nadeau.fr… SommaireEntretien avec Alain Rogerpar Pascal EngelLa bêtise artificiellepar Agnès DesartheNoms d’oiseauxpar Anne SimonLes parias nombreux de l’intelligencepar Julien ZanettaBêtes à croquerpar Claude Grimal
↧
1er Conrgès modial des chercheurs francophones (Accra, Ghana)
1 er APPEL A COMMUNICATION LA RECHERCHE FRANCOPHONE ET L’HUMANITÉ: INTERROGER LES LETTRES ET LES SCIENCES SOCIALES/HUMAINES L’ACAREF organise le 1 er Congrès des chercheurs/experts francophones à Accra, les 11, 12, 13 et 14 juin 2019. Il est question ici d’un rendez-vous d’échanges d’expériences et de mutualisation des compétences francophones en vue d’impacter davantage l’humanité. En effet, depuis un certain temps maintenant, les recherches anglo-saxonnes sont devenues des références incontournables. Ceci leur confère une visibilité sans pareille dans le concert du monde académique et dans les humanités. Si le phénomène est très présent au nord, il ne l’est pas moins au sud. Ce congrès se propose donc d’interroger les Lettres et les Sciences humaines/sociales sur leurs apports à l’humanité et de se faire l’écho des avancées de la recherche francophone. L’ACAREF: Un réseau de promotion des recherches francophones (www.acarefdella.org) L’ACAREF est une structure de mutualisation et de coopération entre enseignants, enseignant-chercheurs, chercheurs et experts dans une perspective pluri/transdisciplinaire. L’ACAREF est née de la synthèse des rencontres qui ont eu lieu entre chercheurs de différentes spécialités et de différentes nationalités au cours de ces quatre dernières années (2015-2018) à l’Université de Legon, Accra, au Ghana, à l’initiative du laboratoire DELLA du Département de français. L’ACAREF agit comme une force de changement et de progrès par sa contribution intellectuelle, culturelle et scientifique à l’épanouissement de la société. Elle exerce ses activités dans tous les champs du savoir en rapport avec les langues et les cultures, et rayonne en rassemblant des travaux qu’elle partage et diffuse de par le monde. L’ACAREF exerce un rôle de leader, de rassembleur et de partenaire auprès des centres de recherche, des chercheurs, des organismes communautaires et des instances gouvernementales, dans le but de promouvoir une plus grande connaissance de la situation de la langue française et des langues africaines, et une meilleure compréhension des enjeux prioritaires qui les concernent. L’ACAREF s'engage à rendre publics, en collaboration avec ses partenaires, des travaux d’enseignement et de recherche pertinents pour le développement et la connaissance de ces langues et de ces cultures. Par la pertinence et la qualité des recherches qu’elle diffuse, la force de ses partenariats et l’expertise de son comité scientifique et de son Conseil d’administration, de ses membres et de ses membres associés, l’ACAREF s’offre comme un creuset de réflexion scientifique en Afrique et à travers le monde et entend, de ce fait, se positionner comme une référence incontournable sur la scène de la recherche dans les domaines connexes à la langue française et aux langues et cultures africaines. L’ACAREF agit pour la défense et la liberté de pensée et d'expression dans l'exercice de ses fonctions de diffusion des recherches basées sur la valeur critique du travail intellectuel et sa portée sociale… Le 1 er Congrès mondial des Chercheurs/Experts francophones: UN CONGRÈS PASSIONNÉ… Ce congrès peut être qualifié de «passionné» de par sa thématique brûlante et fédératrice. En effet, les conférences et les communications porteront sur la question brûlante de la place présente et à venir des recherches en lettres et sciences humaines dans le concert du monde. En clair, le présent Congrès repose précisément sur le principe des recherches et études francophones conçues et vécues comme vecteurs d’enthousiasme, d’innovation, de diversité, de pluralité, de dialogue et d’émergence pour que le monde tourne mieux et que son concert ne devienne ni monotone ni cacophonique. Le congrès se propose d’interroger les Lettres et les Sciences humaines/sociales sur leurs apports à l’Humanité. De ce fait, le présent congrès se veut un rendez-vous pluriel et pluridisciplinaire et se concentrera sur une thématique qui sera creusée sur la base d’une série de symposiums issus des différents domaines des Lettres et des Sciences sociales. Ces symposiums ne viseront pas seulement les expériences isolées des participants (chercheurs ou d’enseignants-chercheurs, experts ou praticiens) mais aussi les relations personnelles que chacun d’entre eux entretient avec les autres disciplines. Pour ce faire, les communications porteront sur tous les champs disciplinaires des domaines suivants : Symposium 1. Linguistique et Communication Symposium 2. Lettres modernes Symposium 3. Histoire Symposium 4. Géographie Symposium 5. Anthropologie Symposium 6. Sciences de l’éducation Symposium 7. Sociologie Symposium 8. Traduction/interprétation. Symposium 9. Langues vivantes Symposium 10. Arts Toutes les propositions d’intervention devront être envisagées dans une perspective pluri/transdisciplinaire. Cette rencontre internationale a plusieurs objectifs :Contribuer à la valorisation et à une plus large diffusion des recherches francophones, à leur visibilité internationale,Faciliter la coordination institutionnelle de ces recherches et de nouvelles formes de coopération,Encourager l’émergence de nouvelles thématiques ainsi que les approches interdisciplinaires et transversales au sein des Lettres et des Sciences humaines et sociales. Ouvert à toutes et à tous, chercheurs confirmés, jeunes chercheurs, doctorants, ce congrès articulera séances plénières et ateliers. Les propositions attendues peuvent prendre la forme de communications individuelles ou d’ateliers coordonnés par un ou deux responsables. Les propositions de posters et d’exposition de livres sont également les bienvenues. Ces propositions s’inscriront de façon privilégiée dans les dix axes thématiques définis par l’ACAREF. UN CONGRÈS AMBITIEUX… Ambitieux, ce 1 er Congrès mondial comme son nom l’indique, veut rassembler les chercheurs francophones dans toutes leurs composantes disciplinaires. Ici, la recherche francophone est à comprendre au sens large du terme: tout travail de recherches toute étude et toute expertise portant sur la langue française ou ayant pour langue de diffusion le français. Ambitieux, le congrès se propose d’accueillir entre 500 (minimum) et 1000 (maximum) participants pour animer les différents symposiums étalés sur 5 jours. Chaque symposium comptera entre 50 et 100 communications sur la durée du Congrès, soit environ 15‐20 communications menées en ateliers parallèles avec des moments de dialogue et de synthèse bien définis et ménagés. Des espaces seront aussi prévus pour des expositions (posters, livres, objets d’art) à l’intention des participants qui préfèrent communiquer leurs expériences et leurs projets de cette manière. Il faut préciser que le Congrès comportera des conférences, en séances plénières, qui seront animées par les organisateurs et leurs différents partenaires institutionnels ainsi que par des experts de la francophonie : écrivains, scientifiques et politiques. Des conférences semi‐plénières, communes à plusieurs symposiums seront aussi au programme du congrès. Elles sont destinées à explorer les lignes transversales entre les différents symposiums afin d’en déduire des approches interdisciplinaires et de lancer de nouvelles pistes de réflexions. UN CONGRÈS : TROIS TABLES RONDES Le congrès ouvrira des débats publics sur des thèmes d’actualité. Il s’agit des thèmes qui interpellent l’opinion publique. Ces débats prendront la forme de tables rondes élargies au grand public. Les intervenants sur ces thèmes sont appelés à y porter un regard purement scientifique et dépassionné. Trois thèmes sont à l’honneur:Gouvernance et gestion des universités en Afrique : état des lieux, défis et perspectivesGouvernance, Conflits et Développement inclusif en Afrique : Entre discours et réalitéL’expertise francophone: états-des-lieux, défis et perspectives UN CONGRÈS FÉDÉRATEUR… Le congrès s’inscrit dans la vision globale de l’ACAREF: rassembler les enseignants, enseignant-chercheurs, chercheurs et Experts dans une perspective pluri/transdisciplinaire afin de mutualiser et diffuser leurs travaux de par le monde. Au-delà de cette vision, le congrès se propose de réunir un ensemble d’institutions universitaires, d’organismes internationaux, d’associations et de réseaux de chercheurs et/ou d’expert. La participation de la plupart des organismes suivants est déjà acquise: - Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)/BRAO Lomé, Togo. - University of Ghana, Legon. - Université Naples Federico II, Italie. - Centro Studi Sociolingua (promotion de la diversité linguistique) Teramo (Italie) - Association LEM-Italia (Langues d'Europe et de la Méditerranée), Italie - Centre d’Etudes Linguistiques et Historiques par Tradition Orale (CELHTO), Bureau Union Africaine (UA) – Niamey, Niger - Académie Africaine des Langues (ACALAN), Union Africaine (UA)-Bamako, Mali - l’Institut Ivoirien des Langues appliquées, Université de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire - le RUIPI (Réseau Universitaire International Pour l’Interculturel), Université Trè-Roma, Italie - La Renaissance Française, Paris France - l’IDEFFIE (Initiative pour le Développement de l’expertise française et francophone à l’international et en Europe) - le Réseau Populations-Cultures-Langues et Développement (POCLANDE), Université Paris Diderot, France - L’Observatoire Européen du Plurilinguisme (OEP) - L’Institut CEDIMES, Paris France Le comité d’organisation a déjà reçu l’approbation de la plupart de ces institutions qui adhèrent à la vision globale de ce projet et acceptent de collaborer pour la réussite du 1 ER CONGRES MONDIAL DES CHERCHEURS ET EXPERTS FRANCOPHONES par des apports financiers ou en nature et par d’autres formes de prestations. C’est dire que toutes ces organisations vont «libérer» leur force et savoir-faire pour imprimer au congrès son caractère fédérateur. Les organisateurs du congrès sont en contact avec d’autres institutions telles que l’OIF, l’AUF et la liste reste ouverte à bien d’autres encore, pour faire de ce congrès un rendez-vous non seulement mondial mais fédérateur. UN CONGRÈS FESTIF… L’une des particularités de ce congrès, c’est le caractère festif que les organisateurs veulent lui donner. En effet, le présent congrès refuse de s’enfermer dans une tour d’ivoire universitaire souvent caractérisée par des journées essentiellement académiques. Il se fixe pour objectif de créer non seulement un cadre de réflexions et de débats scientifiques mais aussi un rendez-vous festif. Ainsi, plusieurs activités de distraction telles que les visites-guidées, des sorties libres, des soirées culturelles animées par des artistes invités…, meubleront le programme du congrès. Le congrès se veut un rendez-vous où personne ne s’ennuie… et la ville d’Accra qui accueille les congressistes s’y prête bien… UN CONGRÈS HUMANITAIRE… Dans le prolongement du congrès, l’opportunité sera donnée aux jeunes élèves et étudiants anglophones du Ghana de renforcer leur apprentissage du français. Des activités d’encadrement pédagogique telles que les animations socio-éducatives en français et l’aide au renforcement linguistiques des Ghanéens seront organisées. Les travaux pourront durer 2 semaines (minimum) et 4 semaines (maximum). Un appel à volontariat international sera lancé à cet effet. Les congressistes volontaires qui sont intéressés à prendre part à ces activités d’enseignement du français pourront le préciser aux organisateurs du congrès. UN CONGRÈS, UNE NOUVELLE REVUE: «LES CAHIERS DE L’ACAREF» UN CONGRÈS FRANCOPHONE EN MILIEU ANGLOPHONE… Accra, la ville qui abritera ce congrès est la capitale du Ghana, pays anglophone coincé entre trois pays francophones (Togo, Côte d’Ivoire et Burkina Faso) et l’océan Atlantique. Et pourtant elle accueille ce 1er congrès mondial des chercheurs francophones. Plusieurs raisons justifient ce choix… Accra a été le lieu de plusieurs rencontres francophones à travers la naissance du laboratoire DELLA (Didactique et Enseignement des Langues et Littérature en Afrique) au sein du Département de Français à l’Université de Legon, Accra. Ce laboratoire créé en 2014 a tenu successivement à l’University of Ghana (Legon) 3 colloques internationaux (entre 2015 et 2018) en français avec la participation, en moyenne, de 100 personnes. C’est de ces rencontres francophones annuelles qu’est né le Réseau ACAREF (Académie Africaine des Recherches et Etudes Francophones) qui organise ce 1er congrès mondial des chercheurs francophones qui se présente comme le couronnement de l’ensemble des 3 éditions successives du colloque DELLA: Accra ne pouvait en être privé… D’un autre côté, la ville d’Accra regorge de nombreux francophones, surtout étudiants. Les statistiques disent qu’un dixième la population d’Accra est francophone ou d’origine francophone. Et puis le Ghana, pays entourés de voisins francophones est très demandeur de langue française. Le pays est membre de l’OIF. DATES, LIEU ET LANGUES DU CONGRÈS Dates : 11, 12, 13 et 14 juin 2019 Lieu : Université du GHANA, LEGON (Accra) . LANGUE DU CONGRÈS Les communications sont prioritairement attendues en français . Cependant, des contributions en anglais pourraient aussi être acceptées mais les intervenants auront à fournir la version finale de leur texte traduit en français. PROPOSITIONS DE COMMUNICATIONS Format des propositions de communication F ormat des propositions individuelles : résumé en français (500 caractères) ; brève présentation du ou des intervenant-e-s mentionnant leur rattachement institutionnel éventuel et leurs coordonnées ainsi que leurs principaux axes de recherches. F ormat des propositions d’ateliers : résumé de 500 caractères en français de la problématique générale de l’atelier ; résumés en 2000 caractères des quatre communications composant l’atelier ; brève présentation du ou des intervenant-e-s mentionnant leur rattachement institutionnel éventuel et leurs coordonnées ainsi que leurs principaux axes de recherches. F ormat des posters : résumé de 500 caractères en français de la problématique générale du poster. NB: Les participants devront mentionner, au bas du titre de leur communication, le symposium du congrès auquel se rattache leur communication. Votre contribution doit être envoyée au comité d’organisation à l’adresse suivante: E-mail: congresmondial1.acarefdella@gmail.com Site web: www.acarefdella.org DATES IMPORTANTESDates du congrès: 11 au 14 juin 2019Lancement de l’appel: 15 juillet 2018Date limite de réception des propositions: 30 octobre 2018Réponses : Entre le 15 et le 20 novembre 2018Début des inscriptions: 21 NOVEMBRE 2018 Comité scientifique international - AFELI Kossi Antoine, Lomé, Togo - AGBEFLE Koffi, Legon, Ghana - AGBESSIME Nyuiamedji, CIREL-VB/UL, Togo - AGRESTI Giovanni, Naples « Federico II », Italie - AMEGBLEAME Simon, Lomé, Togo - AZANKU Kofi, Legon, Ghana - BADASU Cosmas. K., Legon, Ghana, - BAKA Edem, Cape Coast, Ghana - BOUSTANY Daisy, Montréal, Canada - DAO Yao, Lyon 2, France - DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, France - DUMONT Pierre, Montpellier 3, France - HANANIA Lilian, Paris, France - HIEN Amélie, Université Laurentienne, Canada - IMOROU Abdoulaye, Ghana, Legon - KIANGBENI Kévin, Brazaville, Congo - KOUDJO Bienvenu, Abomey Calavi, BENIN - LEMAIRE Eva, Université d’Alberta, Canada - LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d’Ivoire - MAURER Bruno, Montpellier 3, France - MBALA ZE Barnabe, Yaoundé 1, Cameroun - NAPON Abou, Ouagadougou, Burkina Faso - NAPORN Clarisse, Abomey Calavi, Bénin - NDIBNU Julia, Yaoundé 1, Cameroun - NOYAU Colette, Paris, France - NUTAKOR Mawushi, Ghana, Legon - RAONISON N’jaka, Antanararivo, Madagascar - SANDS Sarah, Strasbourg, France - TCHEHOUALI Destiny, Montréal, Canada - TIJANI Mufutau A., PhD, A. Bello University Zaria, Nigéria - TUBLU Yves, Niamey, Niger - WIGHAM Ciara R, Lyon 2, France - YEBOUA Kouadio D., Legon, Ghana - YENNAH Robert, Ghana, Legon
↧
C. Ippolito (dir.), La Littérature et la vie
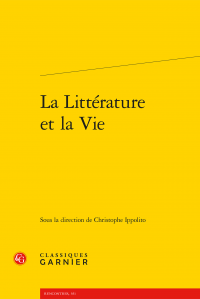 La Littérature et la vie Christophe Ippolito (dir.) Paris,Classiques Garnier, 2018 coll.«Rencontres», n°351, série «Littérature des xx e et xxi e siècles», n°32. EAN13: 9782406067412 333 pages 39,00 € PRESENTATION Comment analyser les liens qui unissent vie et littérature? Et que faire de la notion de vie en théorie littéraire? Est-elle seulement nécessaire? Peut-elle servir à quelque chose? Ce sont ces questions que cet ouvrage pose, c’est ce type de questionnement qu’il suggère. Il s’agit ici de réfléchir aux relations entre vie et littérature dans les œuvres littéraires et critiques en français, en anglais et dans d’autres langues, de l’aube de la Révolution industrielle à l’extrême contemporain, aux frontières et implications de la notion de vie en théorie littéraire, aux liens entre réalité, expérience, fiction et mondes possibles, aux récits de vie, à l’esthétique, stylistique et genèse de la vie en littérature, aux liens entre la lecture et la vie enfin. TABLE DES MATIERES Christophe Ippolito Présentation (versions html et PDF en accès libre) PREMIÈRE PARTIE BRÈVE HISTOIRE DES USAGES DE LA NOTION DE VIE EN LITTÉRATURE Marine Riguet Pour une histoire naturelle de la littérature Pierre Monot La lumière, la vie, la lettre et le pain: de l’eucharistie à la découverte de la faim Xavier Le Brun Le concept de monde de la vie comme outil d’analyse littéraire Michael Wiedorn La littérature au service de la Vie chez Deleuze, Guattari et Glissant: vers un vitalisme esthétique Barbara Kaszowska-Wandor Literature as a speculum vitae and literature which discards life DEUXIÈME PARTIE RÉCIT DE VIE, RÉCIT DE SOI Francesca Belviso L’écriture de soi comme mise en scène de la (con) fusion entre la littérature et la vie: Le Métier de vivre de Cesare Pavese Bianca Romaniuc-Boularand Le Livre brisé : une autobiographie au présent Laurence Perrigault Les archives fictionnelles d’Éric Rondepierre Yue Zhuo «La vie comme texte»: le devenir de la biographématique chez le dernier Barthes Éric Le Calvez « Cache ta vie »: Flaubert et les biographèmes Hélène Jaccomard Je est un(e) autre: l’autobiographie dans le journalisme d’immersion TROISIÈME PARTIE FORMES DE VIE Anne Mounic Du « mouvement dans les lignes», ou «l’hypothèse [...] d’un animal plein de génie» Raphaël Rigal «Ut vita poesis»: La représentation poétique de la vie par Dante Gabriel Rossetti Linda Rasoamanana La section Bios des Cahiers valéryens de la Pléiade: des formes de vie… aux notes à faire vivre Simon Stawski «la plus fidèle expression»: écriture et expérience dans la poésie de l’entre-deux guerres Édouard Marsoin Poét(h)ique de la citation vive dans Go Tell It on the Mountain (1953)de James Baldwin Mélissa Fox-Muraton Le roman contre le réel: la littérature existentielle chez Milan Kundera et Imre Kertész Bibliographie Index Résumés Voir le site de l'éditeur...
La Littérature et la vie Christophe Ippolito (dir.) Paris,Classiques Garnier, 2018 coll.«Rencontres», n°351, série «Littérature des xx e et xxi e siècles», n°32. EAN13: 9782406067412 333 pages 39,00 € PRESENTATION Comment analyser les liens qui unissent vie et littérature? Et que faire de la notion de vie en théorie littéraire? Est-elle seulement nécessaire? Peut-elle servir à quelque chose? Ce sont ces questions que cet ouvrage pose, c’est ce type de questionnement qu’il suggère. Il s’agit ici de réfléchir aux relations entre vie et littérature dans les œuvres littéraires et critiques en français, en anglais et dans d’autres langues, de l’aube de la Révolution industrielle à l’extrême contemporain, aux frontières et implications de la notion de vie en théorie littéraire, aux liens entre réalité, expérience, fiction et mondes possibles, aux récits de vie, à l’esthétique, stylistique et genèse de la vie en littérature, aux liens entre la lecture et la vie enfin. TABLE DES MATIERES Christophe Ippolito Présentation (versions html et PDF en accès libre) PREMIÈRE PARTIE BRÈVE HISTOIRE DES USAGES DE LA NOTION DE VIE EN LITTÉRATURE Marine Riguet Pour une histoire naturelle de la littérature Pierre Monot La lumière, la vie, la lettre et le pain: de l’eucharistie à la découverte de la faim Xavier Le Brun Le concept de monde de la vie comme outil d’analyse littéraire Michael Wiedorn La littérature au service de la Vie chez Deleuze, Guattari et Glissant: vers un vitalisme esthétique Barbara Kaszowska-Wandor Literature as a speculum vitae and literature which discards life DEUXIÈME PARTIE RÉCIT DE VIE, RÉCIT DE SOI Francesca Belviso L’écriture de soi comme mise en scène de la (con) fusion entre la littérature et la vie: Le Métier de vivre de Cesare Pavese Bianca Romaniuc-Boularand Le Livre brisé : une autobiographie au présent Laurence Perrigault Les archives fictionnelles d’Éric Rondepierre Yue Zhuo «La vie comme texte»: le devenir de la biographématique chez le dernier Barthes Éric Le Calvez « Cache ta vie »: Flaubert et les biographèmes Hélène Jaccomard Je est un(e) autre: l’autobiographie dans le journalisme d’immersion TROISIÈME PARTIE FORMES DE VIE Anne Mounic Du « mouvement dans les lignes», ou «l’hypothèse [...] d’un animal plein de génie» Raphaël Rigal «Ut vita poesis»: La représentation poétique de la vie par Dante Gabriel Rossetti Linda Rasoamanana La section Bios des Cahiers valéryens de la Pléiade: des formes de vie… aux notes à faire vivre Simon Stawski «la plus fidèle expression»: écriture et expérience dans la poésie de l’entre-deux guerres Édouard Marsoin Poét(h)ique de la citation vive dans Go Tell It on the Mountain (1953)de James Baldwin Mélissa Fox-Muraton Le roman contre le réel: la littérature existentielle chez Milan Kundera et Imre Kertész Bibliographie Index Résumés Voir le site de l'éditeur...
↧
F. Bravo(dir.), Aproximaciones psicoanalíticas al lenguaje literario [ESP]
 Aproximaciones psicoanalíticas al lenguaje literario FedericoBravo (dir.) Eduvim (Editorial Universitaria de Villa María), Córdoba (Argentina) Collection "Cuadernos de Investigación", 2018 EAN13 : 9789876994798. Prix: $370.00 428 pages PRESENTACIÒN / PRESENTATION Los artículos que componen este libro saldan una vieja deuda del desencuentro entre el psicoanálisis y la lingüística. Cada uno de los trabajos desarrolla desde su propia perspectiva algún aspecto de la teoría o de la praxis analítica, siempre en relación con el discurso literario en sus distintos géneros: narrativo, poético, o dramatúrgico. Cervantes, Tirso de Molina, Sarmiento, García Lorca, Borges, Neruda, Di Benedetto, Pizarnik, Saer, Piglia, son algunos de los nombres que el lector encontrará conforme avance en su recorrido. Con el psicoanálisis como marco de referencia, este trabajo, realizado con el aporte de una docena de especialistas de Francia, España, Argentina y Uruguay, busca entablar un diálogo fecundo con otros estudios especializados y actuales dentro del espacio de la crítica literaria, como así también ofrecer un excelente estímulo al lector no experimentado en la temática desarrollada en sus páginas. INDICE / TABLE DES MATIERES A modo de introducción (FedericoBravo) I. Por los meandros de la creación Corporalidad y creatividad (José Guimón Ugartechea) Lo real, lo imaginario y lo simbólico en la creación literaria (SantiagoSevilla Vallejo) II. Donde brota la palabra poética Del nacimiento del entusiasmo lírico en el poeta adolescente (EdmundoGómez Mango) Psicoanálisis y poesía (PatriciaLeyack) III. Tramoyas de la ilusión Renegación ( Verleugnung ) e ilusión en el teatro (SadiLakhdari) “El inconsciente estructurado como un teatro”: el lenguaje escénico a la luz de algunos conceptos claves del psicoanálisis (DominiqueBreton) IV. Contar o el arte de la reviviscencia Por las sendas de la memoria (GuillermoBodner) La presencia de la ausencia: el duelo y la melancolía en la literatura y el psicoanálisis (MartínLombardo) V. Tras las huellas de Sherlock Holmes La ficción, vía regia a la verdad. Autobiografía y psicoanálisis (EduardoMüller) El caso del psicoanálisis. Misterios detectivesco-freudianos (Anne-CécileDruet) VI. En el nombre de la madre Complejo de Electra y escena primitiva en la narrativa femenina española de postguerra: hacia un proceso de individuación (MaylisSanta-Cruz) Pulsión escópica y complejo de Edipo, motores de la acción dramática (Isabelle Bouchiba-Fochesato) VII. Estrategias lingüísticas Contar lo que (no) es: elaboración discursiva del relato de sueño (AnaStulic) Los automatismos, sus grados de (in)consciencia y sus manifestaciones en el lenguaje (VioletaBereghici) VIII. En el reino de Babel En la punta de las lenguas. Cuando el discurso en análisis o la escritura literaria utilizan otras lenguas que la materna (Juan EduardoTesone) Sobre losautores A MODO DE INTRODUCCIÒN FedericoBravo, (Université Bordeaux Montaigne) En otoño de 1880, recién defendida su tesis doctoral Sobre el empleo del genitivo absoluto en sánscrito , Ferdinand de Saussure se traslada a París donde permanecerá hasta 1891: en la École Pratique des Hautes Études y durante diez años impartirá, entre otras materias, clases de fonética, gramática gótica, alto alemán antiguo, nórdico antiguo, lituano y gramática comparada de las lenguas latina y griega. Mientras tanto, el 13 de octubre de 1885, Sigmund Freud llega a París para seguir, gracias a una beca, los cursos impartidos por Jean-Marie Charcot en la Salpêtrière: allí permanecerá hasta el 26 de febrero de 1886, estudiando con Charcot y Bernheim los métodos terapéuticos de la hipnosis. Durante seis meses, pues, Saussure y Freud fueron, sin saberlo, vecinos próximos. Pero, si bien coincidieron en el espacio y en el tiempo, el fantaseado encuentro del padre de la lingüística estructural con el fundador del psicoanálisis nunca se produjo. Es posible que, de haberse producido, tampoco hubiera cambiado fundamentalmente la faz de la historia, pero la coincidencia es acuciante y no ha dejado de nutrir la imaginación de biógrafos y estudiosos de ambos campos: después de todo si, en un encuentro improbable, el psicoanalista austríaco acabaría conociendo al mismísimo Sherlock Holmes, ¿por qué no había de toparse, deambulando por las calles de París, con el lingüista suizo? Lo cierto es que Saussure no conoció a Freud y aunque, años más tarde, este último psicoanalizara a su hijo, Raymond de Saussure, tampoco consta que Freud conociera la obra de Saussure. Y es que tan significativo como la cercanía geográfica de los dos científicos en los años 1885-86 me parece el hecho de que, pese a la providencial coincidencia de fechas y lugares, el destino no propiciara finalmente el encuentro de los dos extranjeros en París. Se podrá lamentar el desacierto del azar. Por mi parte, en la cita fallida de los dos sabios, veo la prefiguración de un desencuentro más sintomático y profundo: el de dos disciplinas, igualmente dedicadas al lenguaje y, en teoría, llamadas a complementarse, abocadas, en la práctica y pese a su contigüidad, a ignorarse y a seguir derroteros independientes... SOBRE LOS AUTORES / PRESENTATION DES AUTEURS-TRICES Violeta Bereghici manifiesta desde hace tiempo un interés especial por el estudio de las lenguas extranjeras y más particularmente del español, francés, italiano, inglés, ruso. Tuvo la oportunidad de enseñar el rumano, su lengua materna, en la Universidad Bordeaux Montaigne. Tras haberse graduado en la facultad de estudios ibéricos e ibero-americanos en 2009, empezó a enseñar el español en la misma Universidad así como en diferentes colegios e institutos de Francia y se dedica actualmente a la investigación y a la redacción de una tesis de doctorado en lingüística bajo la dirección del profesor Federico Bravo. La base de reflexión de dicha investigación científica la constituye la noción de “sociación psicológica” enunciada por Ferdinand de Saussure en sus investigaciones de 1906-1909 sobre Los Anagramas, considerados estos últimos como la segunda revolución saussuriana, después del Curso de Lingüística General . Artículos publicados: “Les résonances sémiotiques dans la dynamique signifiante”, “Désir de plaisir : la conception de l’hédonisme dans les écrits de Salvador Dalí”, “ Cántico espiritual de Jean de la Croix et de Blas de Otero. Étude comparative”. Guillermo Bodner . Nacido en Buenos Aires donde cursó sus estudios primarios, su familia se trasladó a Montevideo donde siguió los estudios secundarios, la carrera de Medicina y la especialización en Psiquiatría. Allí también trabó sus primeros contactos con el psicoanálisis a través de grupos de estudios y en la propia cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina que, por entonces, estaba dirigida por un prestigioso psicoanalista Dr. Juan C. Rey. Ejerció durante un tiempo la medicina general y más adelante comenzó a llevar tratamientos psicoterapéuticos bajo supervisión, con la idea de iniciar la formación psicoanalítica en Uruguay. Los acontecimientos de la época, golpes de Estado en varios países de la región entre 1973-75, le obligaron a exiliarse en Europa hasta instalarse en Barcelona. Allí realizó trabajo de asistencia en la Clínica Psiquiátrica de laFacultad de Medicina, dirigida entonces por el Prof. J. Obiols. Poco después comenzó su análisis didáctico con la Dra. Julia Corominas e ingresó en la formación en el Instituto de Psicoanálisis de Barcelona. Al cabo de los años fue reconocido como miembro Asociado y más adelante miembro Titular y posteriormente Miembro Titular con funciones Didácticas. En la Sociedad Española de Psicoanálisis ha desempeñado diversos cargos como Secretario, Secretario Científico y Presidente entre 1999-2003. Actualmente es miembro del Consejo Editorial de la International Journal of Psychoanalysis y representante por Europa en el Comité Ético de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ha publicado numerosos artículos sobre psicoanálisis en revistas de Barcelona, Madrid, Montevideo, Buenos Aires, Bogotá, Roma y otros online. Su interés por la literatura se ha plasmado en algunos trabajos en los que desarrolla la visión psicoanalítica sobre algunos textos literarios. Isabelle Bouchiba-Fochesato es profesora titular de Literatura y Lengua Españolas en la universidad de Bordeaux Montaigne. Se doctoró en 2006 por la misma universidad con una tesis sobre las comedias de Tirso de Molina que se publicó en 2014 con el título Tirso de Molina: un certain art du dialogue théâtral (Publications de l’Université de Saint-Étienne). Sus investigaciones se centran en el análisis del discurso y más particu- larmente del discurso teatral del Siglo de Oro. Dedicó varios artículos al teatro de Tirso de Molina como, últimamente, “Poétique du désir dans Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina” publicado en la revista Criticón en 2017 o “Lo sagrado y lo femenino en el teatro de Tirso de Molina” incluido en La santa Juana y el mundo de lo sagrado , libro publicado por el Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA/IGAS) y el Instituto de Estudios Tirsianos (IET) en 2016. Federico Bravo . Licenciado en filología hispánica por las universidades de Navarra y Burdeos y doctor por esta última, ocupa la cátedra de lingüística en la universidad de Burdeos donde imparte asimismo clases de semiótica y literatura. Dirige el Grupo Interdisciplinario de Análisis Literal, equipo de investigación dedicado al análisis del discurso. Es director científico del Bulletin Hispanique y autor de más de un centenar deestudios de temática lingüística y literaria. Ha publicado trabajos sobre el exemplum medieval, el Cid, don Juan Manuel, Quevedo, Tirso de Molina, Lope de Vega, Valle-Inclán, García Lorca, Miguel Hernández, Luis Cernuda, Juan Benet, Julio Aumente, Sergio Pitol, Mariano Brull, Borges. Sus principales líneas de investigación giran en torno a la iconicidad del lenguaje, el pensamiento analógico y las producciones subliminales. Ha dirigido numerosas obras colectivas, entre otras, Le discours poétique de Miguel Hernández (Presses Universitaires de Bordeaux, 2010), La signature (Presses Universitaires de Bordeaux, 2011), La fin du texte (Presses Universitaires de Bordeaux, 2011), Desafíos y perspectivas de la edición digital (Córdoba, Eduvim, 2012), L ’ argument d ’ autorité (Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2014), L ’ insulte (Presses Universitaires de Bordeaux, 2015). Entre sus principales trabajos destacan los dedicados al estudio, revisión y extensión semiótica de la teoría de los anagramas enunciada por Saussure, en particular su ensayo Anagrammes. Sur une hypothèse de Ferdinand de Saussure (Limoges, Lambert-Lucas, 2011). Último libro publicado: Figures de l ’ étymologie dans l ’ œuvre poétique de César Vallejo (Presses Universitaires de Bordeaux, 2016). Dominique Breton es Profesora de literatura y lingüística hispánicas en la Universidad Michel de Montaigne. Después de una tesis doctoral dedicada a los juegos onomásticos y etimológicos del Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita, prosiguió sus investigaciones sobre el análisis del discurso con especial predilección por el discurso teatral contemporáneo, tanto español como hispanoamericano, desde una perspectiva semiótica con la ambición de dar cuenta de la articulación compleja entre signos, códigos, canales y modalidades dentro de un dispositivo enunciativo específico que construye una relación siempre única entre el actor/ personaje y el espectador. En el marco de la acreditación a cátedra, presentó una monografía inédita sobre la noción de “teatralidad” en el teatro de Federico García Lorca y publicó varios artículos donde privilegia el análisis del “signo” escénico y la relación entre representación teatral y psicoanalítica. Sus líneas de investigación actuales integran otras formas de creación y expresión artística híbridas e intermediales (nuevas formas novelísticas, ciberteatro, “fanfiction”, etc.) focalizándose en la evolución de la relación entre emisores y receptores. Anne-Cécile Druet es doctora en Estudios Románicos-Español por la Universidad de París IV - Sorbona. Actualmente es Maître de Conférences en la universidad Paris-Est Marne-la-Vallée. Su principal tema de investigación es la historia del psicoanálisis en España. Dedicó la tesis doctoral a la entrada del lacanismo en España y, sus últimas líneas de estudio versan sobre la historia del psicoanálisis bajo el régimen de Franco y la introducción del freudismo en la literatura española. Es autora de varias publicaciones entre las que pueden destacarse: “Psychoanalysis in Franco’s Spain” (Joy Damousi & Mariano Plotkin Psychoanalysis and Politics , Oxford University Press, 2012), “The Transatlantic Element: Psychoanalysis, Exile, Circulation of Ideas and Institutionalization Between Spain and Argentina” ( Psychoanalysis and History , 2012), “La psiquiatría española y Jacques Lacan antes de 1975” y “La introducción del psicoanálisis en la literatura española a través de su representación” ( Asclepio , CSIC), “L’apparition du personnage du psychanalyste dans le théâtre espagnol” (Sadi Lakhdari, La construction du personnage l ’ être et ses discours , Paris, Indigo, 2011), “La première représentation de la psychanalyse freudienne dans le roman italien et espagnol : Svevo et Domenchina, perspectives comparées” (Elena Bovo, Antonella Braida & Alberto Bram- billa, Interprétations de la pensée du soupçon au tournant de XIXème siècle. Lectures italiennes de Nietzsche, Freud, Marx , Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2013). Edmundo Gómez Mango . Nacido en 1940 en Montevideo, Uruguay, cursa estudios universitarios de medicina, psiquiatría y literatura. Obtiene en 1967 el doctorado de Medicina. Es Jefe de clínica psiquiátrica de la Facultad de Medicina, Profesor de Literatura francesa, y Literatura General III del Instituto de Profesores Artigas, Montevideo. En 1972-73 es Asistente médico extranjero del Hospital Sainte Anne de París, en el servicio del Profesor Georges Daumezon, y obtiene una maestría de Psi- coanálisis y Literatura en la Sorbona, París VII, en el Departamento de Ciencias y Documentos dirigido por la Profesora Julia Kristeva. Desde 1976 reside en París, donde ejerce como médico psiquiatra y como psicoanalista, miembro titular y ex-Presidente de la Asociación psicoanalítica de Francia. Dicta cursos de Psicoanálisis y Literatura en la Universidad Paris VII. Publica una veintena de artículos en la Nouvelle revue de psycha- nalyse , y es miembro del comité de redacción de la revista penser/rêver .Entre sus últimas publicaciones, en castellano: Crónicas de la amistad y del exilio , Banda oriental, 2011 (Premio al ensayo, Ministerio de Cultura del Uruguay). En francés: Un muet dans la langue , Paris, Gallimard, Connaissance de l’inconscient, 2009, Freud avec les écrivains , co-escrito con J.-B. Pontalis, Paris, Gallimard, Connaissance de l’inconscient, 2012, traducido al portugués (edición Tres Estrelas, São Paulo, 2013) y al español (edición Nueva Visión, Buenos Aires, 2014). José Guimón (†) Catedrático emérito de Psiquiatría de la Universidad del País Vasco y Profesor Honorario de la Universidad de Ginebra, cuyo departamento de psiquiatría dirigió durante nueve años, fue Adjunct Clinical Professor de la New York University. Estudió medicina en Barcelona, especializándose en Ginebra y Nueva York (con Becas Ford y Fullbright), y combinó durante cincuenta años la asistencia clínica con la investigación, la docencia y la publicación de estudios científicos. Fue miembro de las comisiones para el Plan de Reforma de Psiquiatría de Euskadi, miembro de la comisión para el Plan de Reforma de Psiquiatría del Estado español y presidente de la comisión española de la especialidad de Psiquiatría. Durante diez años fue experto de la OMS y Director del Centro Colaborador de Investigación y Docencia de ese organismo en Ginebra. Fue miembro de la Real Academia de Medicina de España, socio de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, miembro de honor de la Asociación Mundial de Psiquiatría, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Fue galardonado, entre otras distinciones, con el Premio Nacional de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, el Premio Alfredo Alonso Allende de Neuropsiquiatría, el Premio Vizcaya y el Primer Premio Ajuriaguerra. Autor de más de 300 trabajos científicos, entre ellos 50 libros en distintos idiomas, su último trabajo, junto con el que se recoge en este volumen, se titula Arte y salud mental ¿Existen terapias artísticas? (Madrid, Eneida, 2016). Sadi Lakhdari es catedrático emérito de literatura de la Universidad Paris-IV-Sorbonne, donde ha dirigido durante más de diez años el Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Mondes Ibériques . Ha coordinado los libros Lectures psychanalytiques croisées (Paris, Indigo, 2008), La construction du personnage: l ’ être et ses discours (Paris, Indigo, 2011), Voces de Galicia (Paris, Indigo, 2012) y Le secret (Iberic@l | Revue d’études ibériques et ibéro-américaines, 2012). Es autor, señaladamente, de Ángel Guerra de Benito Pérez Galdós (Paris, Éditions Hispaniques, 1995) y “Ángel Guerra” de Benito Pérez Galdós. Une étude psychanalytique (Paris, L’Harmattan, 1996, 280) y de las ediciones de Tristana , La de Bringas y Ángel Guerra de Benito Pérez Galdós (Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, 2006 y 2013, respectivamente). Patricia Leyack es Licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Sostiene su práctica psicoanalítica en Buenos Aires, ciudad donde reside. Es analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires (EFBA). Enseña tanto en la EEBA como en distintas instituciones de la capital y del interior del país. Supervisa la práctica clínica de analistas en hospitales e instituciones de formación de analistas. Participa con presentación de trabajos en los Congresos de Convergencia y en las Reuniones Lacanoamericanas, ambos internacionales de frecuencia bianual. Publica artículos en los Cuadernos Sigmund Freud , órgano de difusión y transmisión del psicoanálisis de la EFBA, y también en Lalengua , revista de Convergencia. Es autora de La letra interrogada. Leer y escribir en literatura y psicoanálisis (Editorial Escuela Freudiana de Buenos Aires, 2006) y Escrituras en el análisis (en prensa). Martín Lombardo es docente-investigador de la Université Savoie Mont Blanc, en donde dicta clases de literatura e historia latinoamericanas. Es psicólogo por la Universidad de Buenos Aires y doctor en estudios iberamericanos por la Université Bordeaux Montaigne. Su tesis doctoral estudia el vínculo entre la configuración de la ley en el discurso político y en el discurso literario argentino de las últimas décadas. Publicó artículos en revistas académicas de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Italia y Francia. En el año 2015 obtuvo un accésit en el Premio Lucian Freud con un ensayo sobre el abordaje de la locura en la literatura y el psicoanálisis. Eduardo Manuel Müller . Psicólogo, realiza su práctica clínica desde 1978. Supervisor de residencias y servicios de múltiples hospitales públicos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Coordinador de talleres de escritura de materiales clínicos de hospitales públicos, instituciones de salud mental, organismos de derechos humanos y grupos privados. Colaborador permanente como crítico de libros del Suplemento Literario del diario La Nación desde 1984 a 2001. Colaborador del suplemento de Psicología del diario Página 12 . Publicó notas en los diarios Clarín y El Cronista . Y en distintas revistas de salud mental: Topía , El psicoanalítico , Psiqué , Revista Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados , Psicolibro , Controversias , etc. Presentador de múltiples libros de psicoanálisis en la Feria del Libro, en el teatro San Martín, en la Biblioteca Nacional y en distintas instituciones culturales y psicoana- líticas. Autor de distintos reportajes en Psicolibro , entre ellos a Elizabeth Roudinesco, Juan David Nasio, Judith Miller, Silvia Bleichmar, Germán García, Luis Gusman, Emilio Rodrigué, etc. Maylis Santa-Cruz es profesora titular de Literatura, Civilización y Lengua Españolas en la universidad de Bordeaux Montaigne. Se doctoró en 2009 por la misma universidad con una tesis sobre la novela de formación femenina en la literatura española de posguerra. Sus investigaciones se centran principalmente en las novelas escritas por mujeres en los siglos XIX y XX entre las cuales se encuentran, Ana María Matute, Dolo- res Medio o Carmen Laforet. Dedicó varios artículos a estas autoras así como a la enseñanza de la literatura entre los cuales cabe mencionar “La construction de l’identité féminine dans le roman de formation d’après guerre” (PUR, 2018), “Réécriture au féminin de l’histoire du vin en Espagne: une nouvelle de Rosa Regás” (PUB 2017) o “Lire et écrire avec les TICE: l’enseignement de la littérature en langue étrangère à l’université” (L’Harmattan 2017). Coordinó, en 2014, con Amélie Florenchie un número del Bulletin Hispanique dedicado al tema de la referencialidad/autorreferencialidad en la novela española contemporánea y está preparando el volumen Femmes et vin: dialogue entre cultures que será publicado por las Presses Universitaires de Bordeaux. Santiago Sevilla Vallejo . Doctor en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Estudios Literarios, Máster de Profesorado y Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la misma universidad, Licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas. Defendió su tesis sobre la teoría y la práctica literaria de Gonzalo Torrente Ballester en 2014. Ha impartido clases de Lengua y Literatura en diversos colegios. En el ámbito universitario, ha dado clase en el Máster en Formación del Profesorado del Centro Universitario Villanueva. También, ha dado clase en el Grados de Educación Infantil Bilingüe y Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente, enseña habilidades comunicativas y psicología en el Máster de profesorado de la Universidad Rey Juan Carlos y Literatura en el Grado en Educación Primaria de la Universidad Nebrija. Ha sido Secretario de la Federación de Asociación de Profesores de Español. Miembro del consejo de redacción de la Revista Cálamo FASPE . Su línea de investigación se centra en el valor de la identidad para fines educativos, literarios y psicológicos. Asimismo, escribe el blog Vivir de los cuentos . Ana Stulic es profesora titular de lingüística hispánica en la Universidad Bordeaux Montaigne, y miembro del grupo de investigación GRIAL (Groupe Interdisciplinaire d’Analyse Littérale). En su tesis de doctorado sobre el español sefardí, La grammaire de loke et siendo (ke) en judéo-espagnol des Balkans dirigida por Nadine Ly (2007), ha estudiado varios fenómenos de gramaticalización relacionados con la elaboración discursiva. Sus trabajos posteriores sobre el judeoespañol y el problema de la revitalización de esta variedad lingüística en peligro de desaparición la han conducido a plantear en el plano teórico el problema de la enunciación en el medioambiente digital, tanto en el contexto de una lengua minoritaria (documentación y elaboración de un corpus digital, actitudes lingüísticas y valoración de la lengua, plurilingüismo en la Web) como a través del estudio de las prácticas discursivas ordinarias en el entorno digital de modo general. Juan Eduardo Tesone se graduó de médico en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor en 1973. Residente de Psicopatología en el Hospital de Niños de Buenos Aires. En el año 1976 se traslada a Francia para especializarse en el Centro A. Binet de París, ciudad en donde reside 22 años, hasta el año 1998 en que regresa a Argentina. Fue Médicoresidente en Psiquiatría del Hospital la Salpêtrière de París y dirigió durante 15 años un Centro de Psicoterapias ambulatorias en París, 10 arr. Fue asesor del Ministerio de Bienestar Social de Francia. Psiquiatra de la Universidad de París XII, psicoanalista, miembro titular de la “Société Psychanalytique de Paris”, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Miembro de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA). Profesor universitario en Argentina, Río de Janeiro, Lisboa y París. Profesor Asociado de la Universidad de Paris-Ouest Nanterre. Autor de nume- rosos artículos en revistas especializadas, en castellano, francés, italiano, inglés, alemán, portugués, turco y croata. Co-autor de varios libros: Manual de Psiquiatría , Zagreb, 1988; Adolescenza e Psicoanalisi , Milán, Ediciones APP, 1995; Dictionnaire International de Psychanalyse , París, Ed. Calman-Levy, 2001; 60 años de psicoanálisis en Argentina , Buenos Aires, Lumen, 2002; Incest , Londres, Karnac, 2005; Interdits et tabous , París, PUF, 2006; Laberintos de la Violencia , Buenos Aires, Ed. Lugar y APA, 2008; Le sexuel, ses différences et ses genres , París, Ed EDK, 2011; Women and Creativity , Londres, Karnac, 2014; Lo disruptivo en el cine , Buenos Aires, Letra Viva, 2014; Homosexualities , Londres, Karnac, 2015; De Pánicos y Furias (Clínica del desborde) , Buenos Aires, APA y Lugar editorial, 2016; Changing Sexualities an Parental Functions in the 21st Century , Londres, Karnac, 2016. Autor de En las huellas del nombre propio” (Lo que los otros inscriben en nosotros) , Buenos Aires, Letra Viva, 2009 y 2011 (edición española, Biblioteca Nueva, Madrid 2016), escrito en francés por el autor y publicado en París (PUF, 2013), traducido al inglés (Karnac, 2011), al turco (2013), al alemán (2016) y al italiano (previsto 2017). Por este libro recibió en Buenos Aires (2011) un premio de la Secretaría de Cul- tura de la Nación. Condecorado por el Gobierno francés (2012) como Chevalier de l’Ordre National du Mérite . Voir le site de l'éditeur...
Aproximaciones psicoanalíticas al lenguaje literario FedericoBravo (dir.) Eduvim (Editorial Universitaria de Villa María), Córdoba (Argentina) Collection "Cuadernos de Investigación", 2018 EAN13 : 9789876994798. Prix: $370.00 428 pages PRESENTACIÒN / PRESENTATION Los artículos que componen este libro saldan una vieja deuda del desencuentro entre el psicoanálisis y la lingüística. Cada uno de los trabajos desarrolla desde su propia perspectiva algún aspecto de la teoría o de la praxis analítica, siempre en relación con el discurso literario en sus distintos géneros: narrativo, poético, o dramatúrgico. Cervantes, Tirso de Molina, Sarmiento, García Lorca, Borges, Neruda, Di Benedetto, Pizarnik, Saer, Piglia, son algunos de los nombres que el lector encontrará conforme avance en su recorrido. Con el psicoanálisis como marco de referencia, este trabajo, realizado con el aporte de una docena de especialistas de Francia, España, Argentina y Uruguay, busca entablar un diálogo fecundo con otros estudios especializados y actuales dentro del espacio de la crítica literaria, como así también ofrecer un excelente estímulo al lector no experimentado en la temática desarrollada en sus páginas. INDICE / TABLE DES MATIERES A modo de introducción (FedericoBravo) I. Por los meandros de la creación Corporalidad y creatividad (José Guimón Ugartechea) Lo real, lo imaginario y lo simbólico en la creación literaria (SantiagoSevilla Vallejo) II. Donde brota la palabra poética Del nacimiento del entusiasmo lírico en el poeta adolescente (EdmundoGómez Mango) Psicoanálisis y poesía (PatriciaLeyack) III. Tramoyas de la ilusión Renegación ( Verleugnung ) e ilusión en el teatro (SadiLakhdari) “El inconsciente estructurado como un teatro”: el lenguaje escénico a la luz de algunos conceptos claves del psicoanálisis (DominiqueBreton) IV. Contar o el arte de la reviviscencia Por las sendas de la memoria (GuillermoBodner) La presencia de la ausencia: el duelo y la melancolía en la literatura y el psicoanálisis (MartínLombardo) V. Tras las huellas de Sherlock Holmes La ficción, vía regia a la verdad. Autobiografía y psicoanálisis (EduardoMüller) El caso del psicoanálisis. Misterios detectivesco-freudianos (Anne-CécileDruet) VI. En el nombre de la madre Complejo de Electra y escena primitiva en la narrativa femenina española de postguerra: hacia un proceso de individuación (MaylisSanta-Cruz) Pulsión escópica y complejo de Edipo, motores de la acción dramática (Isabelle Bouchiba-Fochesato) VII. Estrategias lingüísticas Contar lo que (no) es: elaboración discursiva del relato de sueño (AnaStulic) Los automatismos, sus grados de (in)consciencia y sus manifestaciones en el lenguaje (VioletaBereghici) VIII. En el reino de Babel En la punta de las lenguas. Cuando el discurso en análisis o la escritura literaria utilizan otras lenguas que la materna (Juan EduardoTesone) Sobre losautores A MODO DE INTRODUCCIÒN FedericoBravo, (Université Bordeaux Montaigne) En otoño de 1880, recién defendida su tesis doctoral Sobre el empleo del genitivo absoluto en sánscrito , Ferdinand de Saussure se traslada a París donde permanecerá hasta 1891: en la École Pratique des Hautes Études y durante diez años impartirá, entre otras materias, clases de fonética, gramática gótica, alto alemán antiguo, nórdico antiguo, lituano y gramática comparada de las lenguas latina y griega. Mientras tanto, el 13 de octubre de 1885, Sigmund Freud llega a París para seguir, gracias a una beca, los cursos impartidos por Jean-Marie Charcot en la Salpêtrière: allí permanecerá hasta el 26 de febrero de 1886, estudiando con Charcot y Bernheim los métodos terapéuticos de la hipnosis. Durante seis meses, pues, Saussure y Freud fueron, sin saberlo, vecinos próximos. Pero, si bien coincidieron en el espacio y en el tiempo, el fantaseado encuentro del padre de la lingüística estructural con el fundador del psicoanálisis nunca se produjo. Es posible que, de haberse producido, tampoco hubiera cambiado fundamentalmente la faz de la historia, pero la coincidencia es acuciante y no ha dejado de nutrir la imaginación de biógrafos y estudiosos de ambos campos: después de todo si, en un encuentro improbable, el psicoanalista austríaco acabaría conociendo al mismísimo Sherlock Holmes, ¿por qué no había de toparse, deambulando por las calles de París, con el lingüista suizo? Lo cierto es que Saussure no conoció a Freud y aunque, años más tarde, este último psicoanalizara a su hijo, Raymond de Saussure, tampoco consta que Freud conociera la obra de Saussure. Y es que tan significativo como la cercanía geográfica de los dos científicos en los años 1885-86 me parece el hecho de que, pese a la providencial coincidencia de fechas y lugares, el destino no propiciara finalmente el encuentro de los dos extranjeros en París. Se podrá lamentar el desacierto del azar. Por mi parte, en la cita fallida de los dos sabios, veo la prefiguración de un desencuentro más sintomático y profundo: el de dos disciplinas, igualmente dedicadas al lenguaje y, en teoría, llamadas a complementarse, abocadas, en la práctica y pese a su contigüidad, a ignorarse y a seguir derroteros independientes... SOBRE LOS AUTORES / PRESENTATION DES AUTEURS-TRICES Violeta Bereghici manifiesta desde hace tiempo un interés especial por el estudio de las lenguas extranjeras y más particularmente del español, francés, italiano, inglés, ruso. Tuvo la oportunidad de enseñar el rumano, su lengua materna, en la Universidad Bordeaux Montaigne. Tras haberse graduado en la facultad de estudios ibéricos e ibero-americanos en 2009, empezó a enseñar el español en la misma Universidad así como en diferentes colegios e institutos de Francia y se dedica actualmente a la investigación y a la redacción de una tesis de doctorado en lingüística bajo la dirección del profesor Federico Bravo. La base de reflexión de dicha investigación científica la constituye la noción de “sociación psicológica” enunciada por Ferdinand de Saussure en sus investigaciones de 1906-1909 sobre Los Anagramas, considerados estos últimos como la segunda revolución saussuriana, después del Curso de Lingüística General . Artículos publicados: “Les résonances sémiotiques dans la dynamique signifiante”, “Désir de plaisir : la conception de l’hédonisme dans les écrits de Salvador Dalí”, “ Cántico espiritual de Jean de la Croix et de Blas de Otero. Étude comparative”. Guillermo Bodner . Nacido en Buenos Aires donde cursó sus estudios primarios, su familia se trasladó a Montevideo donde siguió los estudios secundarios, la carrera de Medicina y la especialización en Psiquiatría. Allí también trabó sus primeros contactos con el psicoanálisis a través de grupos de estudios y en la propia cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina que, por entonces, estaba dirigida por un prestigioso psicoanalista Dr. Juan C. Rey. Ejerció durante un tiempo la medicina general y más adelante comenzó a llevar tratamientos psicoterapéuticos bajo supervisión, con la idea de iniciar la formación psicoanalítica en Uruguay. Los acontecimientos de la época, golpes de Estado en varios países de la región entre 1973-75, le obligaron a exiliarse en Europa hasta instalarse en Barcelona. Allí realizó trabajo de asistencia en la Clínica Psiquiátrica de laFacultad de Medicina, dirigida entonces por el Prof. J. Obiols. Poco después comenzó su análisis didáctico con la Dra. Julia Corominas e ingresó en la formación en el Instituto de Psicoanálisis de Barcelona. Al cabo de los años fue reconocido como miembro Asociado y más adelante miembro Titular y posteriormente Miembro Titular con funciones Didácticas. En la Sociedad Española de Psicoanálisis ha desempeñado diversos cargos como Secretario, Secretario Científico y Presidente entre 1999-2003. Actualmente es miembro del Consejo Editorial de la International Journal of Psychoanalysis y representante por Europa en el Comité Ético de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Ha publicado numerosos artículos sobre psicoanálisis en revistas de Barcelona, Madrid, Montevideo, Buenos Aires, Bogotá, Roma y otros online. Su interés por la literatura se ha plasmado en algunos trabajos en los que desarrolla la visión psicoanalítica sobre algunos textos literarios. Isabelle Bouchiba-Fochesato es profesora titular de Literatura y Lengua Españolas en la universidad de Bordeaux Montaigne. Se doctoró en 2006 por la misma universidad con una tesis sobre las comedias de Tirso de Molina que se publicó en 2014 con el título Tirso de Molina: un certain art du dialogue théâtral (Publications de l’Université de Saint-Étienne). Sus investigaciones se centran en el análisis del discurso y más particu- larmente del discurso teatral del Siglo de Oro. Dedicó varios artículos al teatro de Tirso de Molina como, últimamente, “Poétique du désir dans Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina” publicado en la revista Criticón en 2017 o “Lo sagrado y lo femenino en el teatro de Tirso de Molina” incluido en La santa Juana y el mundo de lo sagrado , libro publicado por el Instituto de Estudios Auriseculares (IDEA/IGAS) y el Instituto de Estudios Tirsianos (IET) en 2016. Federico Bravo . Licenciado en filología hispánica por las universidades de Navarra y Burdeos y doctor por esta última, ocupa la cátedra de lingüística en la universidad de Burdeos donde imparte asimismo clases de semiótica y literatura. Dirige el Grupo Interdisciplinario de Análisis Literal, equipo de investigación dedicado al análisis del discurso. Es director científico del Bulletin Hispanique y autor de más de un centenar deestudios de temática lingüística y literaria. Ha publicado trabajos sobre el exemplum medieval, el Cid, don Juan Manuel, Quevedo, Tirso de Molina, Lope de Vega, Valle-Inclán, García Lorca, Miguel Hernández, Luis Cernuda, Juan Benet, Julio Aumente, Sergio Pitol, Mariano Brull, Borges. Sus principales líneas de investigación giran en torno a la iconicidad del lenguaje, el pensamiento analógico y las producciones subliminales. Ha dirigido numerosas obras colectivas, entre otras, Le discours poétique de Miguel Hernández (Presses Universitaires de Bordeaux, 2010), La signature (Presses Universitaires de Bordeaux, 2011), La fin du texte (Presses Universitaires de Bordeaux, 2011), Desafíos y perspectivas de la edición digital (Córdoba, Eduvim, 2012), L ’ argument d ’ autorité (Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2014), L ’ insulte (Presses Universitaires de Bordeaux, 2015). Entre sus principales trabajos destacan los dedicados al estudio, revisión y extensión semiótica de la teoría de los anagramas enunciada por Saussure, en particular su ensayo Anagrammes. Sur une hypothèse de Ferdinand de Saussure (Limoges, Lambert-Lucas, 2011). Último libro publicado: Figures de l ’ étymologie dans l ’ œuvre poétique de César Vallejo (Presses Universitaires de Bordeaux, 2016). Dominique Breton es Profesora de literatura y lingüística hispánicas en la Universidad Michel de Montaigne. Después de una tesis doctoral dedicada a los juegos onomásticos y etimológicos del Libro de Buen Amor del Arcipreste de Hita, prosiguió sus investigaciones sobre el análisis del discurso con especial predilección por el discurso teatral contemporáneo, tanto español como hispanoamericano, desde una perspectiva semiótica con la ambición de dar cuenta de la articulación compleja entre signos, códigos, canales y modalidades dentro de un dispositivo enunciativo específico que construye una relación siempre única entre el actor/ personaje y el espectador. En el marco de la acreditación a cátedra, presentó una monografía inédita sobre la noción de “teatralidad” en el teatro de Federico García Lorca y publicó varios artículos donde privilegia el análisis del “signo” escénico y la relación entre representación teatral y psicoanalítica. Sus líneas de investigación actuales integran otras formas de creación y expresión artística híbridas e intermediales (nuevas formas novelísticas, ciberteatro, “fanfiction”, etc.) focalizándose en la evolución de la relación entre emisores y receptores. Anne-Cécile Druet es doctora en Estudios Románicos-Español por la Universidad de París IV - Sorbona. Actualmente es Maître de Conférences en la universidad Paris-Est Marne-la-Vallée. Su principal tema de investigación es la historia del psicoanálisis en España. Dedicó la tesis doctoral a la entrada del lacanismo en España y, sus últimas líneas de estudio versan sobre la historia del psicoanálisis bajo el régimen de Franco y la introducción del freudismo en la literatura española. Es autora de varias publicaciones entre las que pueden destacarse: “Psychoanalysis in Franco’s Spain” (Joy Damousi & Mariano Plotkin Psychoanalysis and Politics , Oxford University Press, 2012), “The Transatlantic Element: Psychoanalysis, Exile, Circulation of Ideas and Institutionalization Between Spain and Argentina” ( Psychoanalysis and History , 2012), “La psiquiatría española y Jacques Lacan antes de 1975” y “La introducción del psicoanálisis en la literatura española a través de su representación” ( Asclepio , CSIC), “L’apparition du personnage du psychanalyste dans le théâtre espagnol” (Sadi Lakhdari, La construction du personnage l ’ être et ses discours , Paris, Indigo, 2011), “La première représentation de la psychanalyse freudienne dans le roman italien et espagnol : Svevo et Domenchina, perspectives comparées” (Elena Bovo, Antonella Braida & Alberto Bram- billa, Interprétations de la pensée du soupçon au tournant de XIXème siècle. Lectures italiennes de Nietzsche, Freud, Marx , Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2013). Edmundo Gómez Mango . Nacido en 1940 en Montevideo, Uruguay, cursa estudios universitarios de medicina, psiquiatría y literatura. Obtiene en 1967 el doctorado de Medicina. Es Jefe de clínica psiquiátrica de la Facultad de Medicina, Profesor de Literatura francesa, y Literatura General III del Instituto de Profesores Artigas, Montevideo. En 1972-73 es Asistente médico extranjero del Hospital Sainte Anne de París, en el servicio del Profesor Georges Daumezon, y obtiene una maestría de Psi- coanálisis y Literatura en la Sorbona, París VII, en el Departamento de Ciencias y Documentos dirigido por la Profesora Julia Kristeva. Desde 1976 reside en París, donde ejerce como médico psiquiatra y como psicoanalista, miembro titular y ex-Presidente de la Asociación psicoanalítica de Francia. Dicta cursos de Psicoanálisis y Literatura en la Universidad Paris VII. Publica una veintena de artículos en la Nouvelle revue de psycha- nalyse , y es miembro del comité de redacción de la revista penser/rêver .Entre sus últimas publicaciones, en castellano: Crónicas de la amistad y del exilio , Banda oriental, 2011 (Premio al ensayo, Ministerio de Cultura del Uruguay). En francés: Un muet dans la langue , Paris, Gallimard, Connaissance de l’inconscient, 2009, Freud avec les écrivains , co-escrito con J.-B. Pontalis, Paris, Gallimard, Connaissance de l’inconscient, 2012, traducido al portugués (edición Tres Estrelas, São Paulo, 2013) y al español (edición Nueva Visión, Buenos Aires, 2014). José Guimón (†) Catedrático emérito de Psiquiatría de la Universidad del País Vasco y Profesor Honorario de la Universidad de Ginebra, cuyo departamento de psiquiatría dirigió durante nueve años, fue Adjunct Clinical Professor de la New York University. Estudió medicina en Barcelona, especializándose en Ginebra y Nueva York (con Becas Ford y Fullbright), y combinó durante cincuenta años la asistencia clínica con la investigación, la docencia y la publicación de estudios científicos. Fue miembro de las comisiones para el Plan de Reforma de Psiquiatría de Euskadi, miembro de la comisión para el Plan de Reforma de Psiquiatría del Estado español y presidente de la comisión española de la especialidad de Psiquiatría. Durante diez años fue experto de la OMS y Director del Centro Colaborador de Investigación y Docencia de ese organismo en Ginebra. Fue miembro de la Real Academia de Medicina de España, socio de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, miembro de honor de la Asociación Mundial de Psiquiatría, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Fue galardonado, entre otras distinciones, con el Premio Nacional de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, el Premio Alfredo Alonso Allende de Neuropsiquiatría, el Premio Vizcaya y el Primer Premio Ajuriaguerra. Autor de más de 300 trabajos científicos, entre ellos 50 libros en distintos idiomas, su último trabajo, junto con el que se recoge en este volumen, se titula Arte y salud mental ¿Existen terapias artísticas? (Madrid, Eneida, 2016). Sadi Lakhdari es catedrático emérito de literatura de la Universidad Paris-IV-Sorbonne, donde ha dirigido durante más de diez años el Centre de Recherche Interdisciplinaire sur les Mondes Ibériques . Ha coordinado los libros Lectures psychanalytiques croisées (Paris, Indigo, 2008), La construction du personnage: l ’ être et ses discours (Paris, Indigo, 2011), Voces de Galicia (Paris, Indigo, 2012) y Le secret (Iberic@l | Revue d’études ibériques et ibéro-américaines, 2012). Es autor, señaladamente, de Ángel Guerra de Benito Pérez Galdós (Paris, Éditions Hispaniques, 1995) y “Ángel Guerra” de Benito Pérez Galdós. Une étude psychanalytique (Paris, L’Harmattan, 1996, 280) y de las ediciones de Tristana , La de Bringas y Ángel Guerra de Benito Pérez Galdós (Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, 2006 y 2013, respectivamente). Patricia Leyack es Licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Sostiene su práctica psicoanalítica en Buenos Aires, ciudad donde reside. Es analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires (EFBA). Enseña tanto en la EEBA como en distintas instituciones de la capital y del interior del país. Supervisa la práctica clínica de analistas en hospitales e instituciones de formación de analistas. Participa con presentación de trabajos en los Congresos de Convergencia y en las Reuniones Lacanoamericanas, ambos internacionales de frecuencia bianual. Publica artículos en los Cuadernos Sigmund Freud , órgano de difusión y transmisión del psicoanálisis de la EFBA, y también en Lalengua , revista de Convergencia. Es autora de La letra interrogada. Leer y escribir en literatura y psicoanálisis (Editorial Escuela Freudiana de Buenos Aires, 2006) y Escrituras en el análisis (en prensa). Martín Lombardo es docente-investigador de la Université Savoie Mont Blanc, en donde dicta clases de literatura e historia latinoamericanas. Es psicólogo por la Universidad de Buenos Aires y doctor en estudios iberamericanos por la Université Bordeaux Montaigne. Su tesis doctoral estudia el vínculo entre la configuración de la ley en el discurso político y en el discurso literario argentino de las últimas décadas. Publicó artículos en revistas académicas de Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Italia y Francia. En el año 2015 obtuvo un accésit en el Premio Lucian Freud con un ensayo sobre el abordaje de la locura en la literatura y el psicoanálisis. Eduardo Manuel Müller . Psicólogo, realiza su práctica clínica desde 1978. Supervisor de residencias y servicios de múltiples hospitales públicos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Coordinador de talleres de escritura de materiales clínicos de hospitales públicos, instituciones de salud mental, organismos de derechos humanos y grupos privados. Colaborador permanente como crítico de libros del Suplemento Literario del diario La Nación desde 1984 a 2001. Colaborador del suplemento de Psicología del diario Página 12 . Publicó notas en los diarios Clarín y El Cronista . Y en distintas revistas de salud mental: Topía , El psicoanalítico , Psiqué , Revista Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados , Psicolibro , Controversias , etc. Presentador de múltiples libros de psicoanálisis en la Feria del Libro, en el teatro San Martín, en la Biblioteca Nacional y en distintas instituciones culturales y psicoana- líticas. Autor de distintos reportajes en Psicolibro , entre ellos a Elizabeth Roudinesco, Juan David Nasio, Judith Miller, Silvia Bleichmar, Germán García, Luis Gusman, Emilio Rodrigué, etc. Maylis Santa-Cruz es profesora titular de Literatura, Civilización y Lengua Españolas en la universidad de Bordeaux Montaigne. Se doctoró en 2009 por la misma universidad con una tesis sobre la novela de formación femenina en la literatura española de posguerra. Sus investigaciones se centran principalmente en las novelas escritas por mujeres en los siglos XIX y XX entre las cuales se encuentran, Ana María Matute, Dolo- res Medio o Carmen Laforet. Dedicó varios artículos a estas autoras así como a la enseñanza de la literatura entre los cuales cabe mencionar “La construction de l’identité féminine dans le roman de formation d’après guerre” (PUR, 2018), “Réécriture au féminin de l’histoire du vin en Espagne: une nouvelle de Rosa Regás” (PUB 2017) o “Lire et écrire avec les TICE: l’enseignement de la littérature en langue étrangère à l’université” (L’Harmattan 2017). Coordinó, en 2014, con Amélie Florenchie un número del Bulletin Hispanique dedicado al tema de la referencialidad/autorreferencialidad en la novela española contemporánea y está preparando el volumen Femmes et vin: dialogue entre cultures que será publicado por las Presses Universitaires de Bordeaux. Santiago Sevilla Vallejo . Doctor en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Estudios Literarios, Máster de Profesorado y Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la misma universidad, Licenciado en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas. Defendió su tesis sobre la teoría y la práctica literaria de Gonzalo Torrente Ballester en 2014. Ha impartido clases de Lengua y Literatura en diversos colegios. En el ámbito universitario, ha dado clase en el Máster en Formación del Profesorado del Centro Universitario Villanueva. También, ha dado clase en el Grados de Educación Infantil Bilingüe y Grado de Traducción e Interpretación de la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente, enseña habilidades comunicativas y psicología en el Máster de profesorado de la Universidad Rey Juan Carlos y Literatura en el Grado en Educación Primaria de la Universidad Nebrija. Ha sido Secretario de la Federación de Asociación de Profesores de Español. Miembro del consejo de redacción de la Revista Cálamo FASPE . Su línea de investigación se centra en el valor de la identidad para fines educativos, literarios y psicológicos. Asimismo, escribe el blog Vivir de los cuentos . Ana Stulic es profesora titular de lingüística hispánica en la Universidad Bordeaux Montaigne, y miembro del grupo de investigación GRIAL (Groupe Interdisciplinaire d’Analyse Littérale). En su tesis de doctorado sobre el español sefardí, La grammaire de loke et siendo (ke) en judéo-espagnol des Balkans dirigida por Nadine Ly (2007), ha estudiado varios fenómenos de gramaticalización relacionados con la elaboración discursiva. Sus trabajos posteriores sobre el judeoespañol y el problema de la revitalización de esta variedad lingüística en peligro de desaparición la han conducido a plantear en el plano teórico el problema de la enunciación en el medioambiente digital, tanto en el contexto de una lengua minoritaria (documentación y elaboración de un corpus digital, actitudes lingüísticas y valoración de la lengua, plurilingüismo en la Web) como a través del estudio de las prácticas discursivas ordinarias en el entorno digital de modo general. Juan Eduardo Tesone se graduó de médico en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor en 1973. Residente de Psicopatología en el Hospital de Niños de Buenos Aires. En el año 1976 se traslada a Francia para especializarse en el Centro A. Binet de París, ciudad en donde reside 22 años, hasta el año 1998 en que regresa a Argentina. Fue Médicoresidente en Psiquiatría del Hospital la Salpêtrière de París y dirigió durante 15 años un Centro de Psicoterapias ambulatorias en París, 10 arr. Fue asesor del Ministerio de Bienestar Social de Francia. Psiquiatra de la Universidad de París XII, psicoanalista, miembro titular de la “Société Psychanalytique de Paris”, miembro titular con función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Miembro de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA). Profesor universitario en Argentina, Río de Janeiro, Lisboa y París. Profesor Asociado de la Universidad de Paris-Ouest Nanterre. Autor de nume- rosos artículos en revistas especializadas, en castellano, francés, italiano, inglés, alemán, portugués, turco y croata. Co-autor de varios libros: Manual de Psiquiatría , Zagreb, 1988; Adolescenza e Psicoanalisi , Milán, Ediciones APP, 1995; Dictionnaire International de Psychanalyse , París, Ed. Calman-Levy, 2001; 60 años de psicoanálisis en Argentina , Buenos Aires, Lumen, 2002; Incest , Londres, Karnac, 2005; Interdits et tabous , París, PUF, 2006; Laberintos de la Violencia , Buenos Aires, Ed. Lugar y APA, 2008; Le sexuel, ses différences et ses genres , París, Ed EDK, 2011; Women and Creativity , Londres, Karnac, 2014; Lo disruptivo en el cine , Buenos Aires, Letra Viva, 2014; Homosexualities , Londres, Karnac, 2015; De Pánicos y Furias (Clínica del desborde) , Buenos Aires, APA y Lugar editorial, 2016; Changing Sexualities an Parental Functions in the 21st Century , Londres, Karnac, 2016. Autor de En las huellas del nombre propio” (Lo que los otros inscriben en nosotros) , Buenos Aires, Letra Viva, 2009 y 2011 (edición española, Biblioteca Nueva, Madrid 2016), escrito en francés por el autor y publicado en París (PUF, 2013), traducido al inglés (Karnac, 2011), al turco (2013), al alemán (2016) y al italiano (previsto 2017). Por este libro recibió en Buenos Aires (2011) un premio de la Secretaría de Cul- tura de la Nación. Condecorado por el Gobierno francés (2012) como Chevalier de l’Ordre National du Mérite . Voir le site de l'éditeur...
↧
↧
H.M. Enzensberger, Tumulte
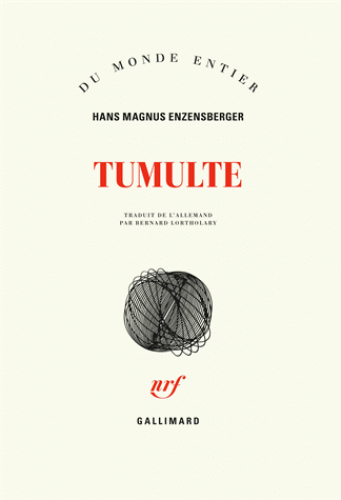 Tumulte Hans Magnus Enzensberger Bernard Lortholary (Traducteur) Date de parution : 03/05/2018 Editeur : Gallimard Collection : Du monde entier ISBN : 978-2-07-014895-0 EAN : 9782070148950 Nb. de pages : 288 p. Lorsqu'on s'apprête à se retrouver soi-même après un demi-siècle, on doit s'attendre à des surprises. Hans Magnus Enzensberger s'est embarqué dans l'aventure. C'est d'une découverte fortuite dans ses archives qu'est née cette confrontation avec le passé, ce regard rétrospectif sur une décennie controversée et agitée, les années 1960. Un premier voyage en 1963 le conduit en Russie, où le hasard voudra qu'il soit reçu dans la datcha de Khrouchtchev. Trois ans plus tard, le voici qui traverse l'URSS de part en part, de l'extrême Sud jusqu'en Sibérie. Durant ce périple se noue la relation avec celle qui deviendra sa deuxième femme, son "roman russe", véritable fil rouge de l'ouvrage. Les années 1968-1969 voient le poète en plein tumulte politique et personnel. Puis, la guerre du Vietnam le pousse à accepter un poste dans une université américaine, avant de se lancer dans les tourments de la révolution à Cuba. Mais les conflits entre factions de l'opposition extra-parlementaire à Berlin ne sont jamais bien loin, dans lesquels notre auteur aura aussi son rôle à jouer. Avec le recul, quel jugement l'Enzensberger d'aujourd'hui porte-t-il sur le jeune homme qu'il fut? La réponse nous est donnée dans la conversation houleuse qu'il imagine entre les deux, et dans laquelle chacun défend chèrement sa peau.
Tumulte Hans Magnus Enzensberger Bernard Lortholary (Traducteur) Date de parution : 03/05/2018 Editeur : Gallimard Collection : Du monde entier ISBN : 978-2-07-014895-0 EAN : 9782070148950 Nb. de pages : 288 p. Lorsqu'on s'apprête à se retrouver soi-même après un demi-siècle, on doit s'attendre à des surprises. Hans Magnus Enzensberger s'est embarqué dans l'aventure. C'est d'une découverte fortuite dans ses archives qu'est née cette confrontation avec le passé, ce regard rétrospectif sur une décennie controversée et agitée, les années 1960. Un premier voyage en 1963 le conduit en Russie, où le hasard voudra qu'il soit reçu dans la datcha de Khrouchtchev. Trois ans plus tard, le voici qui traverse l'URSS de part en part, de l'extrême Sud jusqu'en Sibérie. Durant ce périple se noue la relation avec celle qui deviendra sa deuxième femme, son "roman russe", véritable fil rouge de l'ouvrage. Les années 1968-1969 voient le poète en plein tumulte politique et personnel. Puis, la guerre du Vietnam le pousse à accepter un poste dans une université américaine, avant de se lancer dans les tourments de la révolution à Cuba. Mais les conflits entre factions de l'opposition extra-parlementaire à Berlin ne sont jamais bien loin, dans lesquels notre auteur aura aussi son rôle à jouer. Avec le recul, quel jugement l'Enzensberger d'aujourd'hui porte-t-il sur le jeune homme qu'il fut? La réponse nous est donnée dans la conversation houleuse qu'il imagine entre les deux, et dans laquelle chacun défend chèrement sa peau.
↧
Paul van Ostaijen, Fatalisties liedje / Air fataliste
Paul van Ostaijen, Fatalisties liedje / Air fataliste Bauhaus-XXI, Granville, 2018 Conception typographique, mise en page et quinze dessins à l’encre de Chine et à l’aquarelle par Serge Chamchinov. Texte du poème vérifié par Anne Arc d’après le manuscrit de Paul van Ostaijen. Bilingue, traduction française par Jan H. Mysjkin, avec l’œil complice de Pierre Gallissaires. Format 33,2x33,2 cm, papier Fabriano 225 g/m², polices de caractère Haettenschweiler. Fait à 12 variantes uniques. * Le poème Fatalisties liedje (Air fataliste) fait partie du recueil De feesten van angst en pijn (Les Fêtes d’angoisse et de douleur) écrit par Paul van Ostaijen, poète dadaïste flamand, lors de son séjour à Berlin 1918-1921. Les Fêtes d’angoisse et de douleur contient le cycle des poèmes quasi inconnus pour le lecteur français. La première traduction française a été faite par Jan H. Mysjkin en 2017 et destinée exclusivement pour la création des livres d’artiste en série, dans la collection avant-gardiste ultra contemporaine «Bauhaus-XXI». Le travail artistique est effectué sur la plateforme expérimentale du Laboratoire du livre d’artste (Granville) et il est inscrit dans le cadre du projet monumental de dix-huit volumes (série Les Fêtes d’angoisse et de douleur ) sous forme des œuvres graphiques originales. Aucune édition courante n’est prévue, chaque exemplaire est unique et créé par les artistes du groupe Sphinx Blanc. Les recherches sont menées autour de la réception contemporaine du langage des formes graphico-rythmiques, ces recherches sont effectuées selon la vision actuelle sur le livre d’artiste, respectant les principes de l’art du livre et de la conception du livre d’artiste pour la tradition française lancée dès la fin du XIX e siècle ( cf . E. Manet & S. Mallarmé, Le Corbeau, 1875 ; P. Bonnard & P. Verlaine, Parallèlement, 1900). * BIBLIOGRAPHIE - Gerrit Borgers, Paul van Ostaijen, een documentatie -1, -2 . Den Haag, 1971 - Sonja Neef, Kalligramme. Zur Medialität einer Schrift. Anhand von Paul van Ostaijens De feesten van angst en pijn, ASCA Press, Amsterdam, 2000 - Loïc Guidel, «Dédié à Paul van Ostaijen ( Jazz métaphysique )», in revue critique du livre d’artiste Ligature , n°12, association LAAC, Granville, 2017 - Jean-Pierre Hastaire, «Bauhaus-21. Collection des livres d’artiste» (catalogue), in revue critique du livre d’artiste Ligature , n°13, association LAAC, Granville, 2018 - Paul van Ostaijen, De feesten van angst en pijn (manuscrit fac-similé), Antwerpen, 2006 - Paul van Ostaijen, Metafiziese Jazz, «Jazz métaphysique», Bauhaus-XXI, Granville, 2017 - Paul van Ostaijen, De Moordenaars, «Les Assassins», Bauhaus-XXI, Granville, 2017 - Paul van Ostaijen, Maskers , «Masques», Bauhaus-XXI, Granville, 2017
↧
M. Deguy, L'envergure des comparses. Écologie et poétique
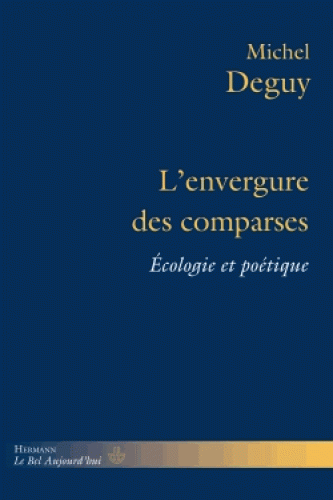 L'envergure des comparses - Écologie et poétique Michel Deguy Date de parution : 22/11/2017 Editeur : Hermann (Editions) Collection : Le Bel Aujourd'hui ISBN : 978-2-7056-9499-9 EAN : 9782705694999 Nb. de pages : 176 p. Pourquoi écologie et poésie ? L'écologie politique et la poétique ? Voici deux choses dont l'affinité n'a pas été pensée jusqu'à présent. La poésie est un mode du penser : voir et montrer le non-encore-visible et le peu-visible. L'écologie est une clairvoyance à longue portée, météoro-logique, qu'alertent les voyants rouges de toutes parts. Comment envisager l'affinité de ces deux disciplines qui sont des enjeux brûlants pour nos sociétés contemporaines ? Leur conjonction et leur articulation s'avèrent indispensables et urgentes. Le présent essai analyse donc la poétique et l'écologie pour mettre en valeur leur inclination, leur réciprocité de preuves échangées, leur mutualisation, leur relation privilégiée, voire leur indivision programmable. Il traite du problème à partir d'aujourd'hui, car c'est d'aujourd'hui qu'il s'agit : poétique pour aujourd'hui ; écologie pour aujourd'hui ; écologie politique et poéthique pour aujourd'hui. "Le XXIe siècle sera poétique... ou rien. " Rien n'est plus urgent que cet "ou rien". Voir le site de l'éditeur… * On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage : "Deguy, une réserve illimitée de possibles", par Stéphane Michaud Les dernières publications de Michel Deguy, poète sans cesse sur la brèche dans son questionnement du monde contemporain et son interrogation sur la nature de la poésie, forcent l’attention. Elles rebattent les cartes et jusqu’à celles de l’écologie, dans l’extension radicale que l’auteur donne à cette cause. Aux impasses contemporaines (consommation effrénée ou tyrannie de l’image), à l’aveuglement auquel concourent les intégrismes et les doxas, Deguy oppose dans le sillage de Baudelaire «l’admirable faculté de poésie».
L'envergure des comparses - Écologie et poétique Michel Deguy Date de parution : 22/11/2017 Editeur : Hermann (Editions) Collection : Le Bel Aujourd'hui ISBN : 978-2-7056-9499-9 EAN : 9782705694999 Nb. de pages : 176 p. Pourquoi écologie et poésie ? L'écologie politique et la poétique ? Voici deux choses dont l'affinité n'a pas été pensée jusqu'à présent. La poésie est un mode du penser : voir et montrer le non-encore-visible et le peu-visible. L'écologie est une clairvoyance à longue portée, météoro-logique, qu'alertent les voyants rouges de toutes parts. Comment envisager l'affinité de ces deux disciplines qui sont des enjeux brûlants pour nos sociétés contemporaines ? Leur conjonction et leur articulation s'avèrent indispensables et urgentes. Le présent essai analyse donc la poétique et l'écologie pour mettre en valeur leur inclination, leur réciprocité de preuves échangées, leur mutualisation, leur relation privilégiée, voire leur indivision programmable. Il traite du problème à partir d'aujourd'hui, car c'est d'aujourd'hui qu'il s'agit : poétique pour aujourd'hui ; écologie pour aujourd'hui ; écologie politique et poéthique pour aujourd'hui. "Le XXIe siècle sera poétique... ou rien. " Rien n'est plus urgent que cet "ou rien". Voir le site de l'éditeur… * On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage : "Deguy, une réserve illimitée de possibles", par Stéphane Michaud Les dernières publications de Michel Deguy, poète sans cesse sur la brèche dans son questionnement du monde contemporain et son interrogation sur la nature de la poésie, forcent l’attention. Elles rebattent les cartes et jusqu’à celles de l’écologie, dans l’extension radicale que l’auteur donne à cette cause. Aux impasses contemporaines (consommation effrénée ou tyrannie de l’image), à l’aveuglement auquel concourent les intégrismes et les doxas, Deguy oppose dans le sillage de Baudelaire «l’admirable faculté de poésie».
↧
M. Deguy, Poèmes et Tombeau pour Yves Bonnefoy
 Poèmes et Tombeau pour Yves Bonnefoy Michel Deguy éditions La Robe Noire 102 pages — 500 exemplaires — Dos carré collé Frontispice, illustration de couverture et cul de lampe en quadrichromie Format à la française 11,4 x 17,6 cm — 10 € ISBN 978-2-9550739-5-7 — Parution Février 2017 Michel Deguy propose ici un recueil original de dix chapitres comme autant de lectures du monde contemporain et du monde poétique. Entre poèmes et définitions de sa poétique, l’auteur déclame un hommage éclairant à son ami disparu le grand poète Yves Bonnefoy. Le texte est précédé d’une illustration originale de l’artiste Michel Canteloup. Michel Deguy est poète et essayiste. Il est l’un des auteurs de poésie les plus importants de sa génération. En 2004 il a reçu le grand prix de poésie de l’académie française parmi beaucoup d’autres distinctions. Il a fondé la revue Po&sie en 1977. Voir le site de l'éditeur… * * On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage: "Deguy, une réserve illimitée de possibles", par Stéphane Michaud Les dernières publications de Michel Deguy, poète sans cesse sur la brèche dans son questionnement du monde contemporain et son interrogation sur la nature de la poésie, forcent l’attention. Elles rebattent les cartes et jusqu’à celles de l’écologie, dans l’extension radicale que l’auteur donne à cette cause. Aux impasses contemporaines (consommation effrénée ou tyrannie de l’image), à l’aveuglement auquel concourent les intégrismes et les doxas, Deguy oppose dans le sillage de Baudelaire «l’admirable faculté de poésie».
Poèmes et Tombeau pour Yves Bonnefoy Michel Deguy éditions La Robe Noire 102 pages — 500 exemplaires — Dos carré collé Frontispice, illustration de couverture et cul de lampe en quadrichromie Format à la française 11,4 x 17,6 cm — 10 € ISBN 978-2-9550739-5-7 — Parution Février 2017 Michel Deguy propose ici un recueil original de dix chapitres comme autant de lectures du monde contemporain et du monde poétique. Entre poèmes et définitions de sa poétique, l’auteur déclame un hommage éclairant à son ami disparu le grand poète Yves Bonnefoy. Le texte est précédé d’une illustration originale de l’artiste Michel Canteloup. Michel Deguy est poète et essayiste. Il est l’un des auteurs de poésie les plus importants de sa génération. En 2004 il a reçu le grand prix de poésie de l’académie française parmi beaucoup d’autres distinctions. Il a fondé la revue Po&sie en 1977. Voir le site de l'éditeur… * * On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage: "Deguy, une réserve illimitée de possibles", par Stéphane Michaud Les dernières publications de Michel Deguy, poète sans cesse sur la brèche dans son questionnement du monde contemporain et son interrogation sur la nature de la poésie, forcent l’attention. Elles rebattent les cartes et jusqu’à celles de l’écologie, dans l’extension radicale que l’auteur donne à cette cause. Aux impasses contemporaines (consommation effrénée ou tyrannie de l’image), à l’aveuglement auquel concourent les intégrismes et les doxas, Deguy oppose dans le sillage de Baudelaire «l’admirable faculté de poésie».
↧
↧
Cahiers de Narratologie , n° 33: "L'art du roman chez Umberto Eco"
Référence bibliographique : Cahiers de Narratologie , n° 33: "L'art du roman chez Umberto Eco", 2018. Le numéro 33 des Cahiers de Narratologie est dirigé par Mohamed Bernoussi, Université de Meknès. La revue consultable en ligne sur OpenEdition Sommaire du numéro :Mohamed BernoussiPréfaceKhalid HadjiLa filature du sens ou l’en-quête dans le Nom de la rose de Umberto EcoGianfranco MarroneNarration et Conspiration. Formes de la bêtise dans le Pendule de FoucaultMassimo LeoneUne rose sans épines: apostille à l’«Apostille au Nom de la rose »Kamal Hayani El MechkouriLa construction de l’espace chez Umberto EcoPatrizia VioliLa Mystérieuse flamme de la reine Loana et l'espace vide de l'individuelMohamed BernoussiBaudolino, une fascination sémiotique pour le mensongeMohamed BernoussiLe rôle de l’image dans Le Cimetière de PragueTariq OukhaddaLa presse entre le vrai et le faux dans Numéro Zéro d’Umberto EcoPiero PolidoroL’apathique et l’esthétique. Réflexions sur les clausules du Nom de la rose et du Pendule de Foucault d’Umberto EcoVariasWenjun DengMalentendu et implicite: une nouvelle interprétation du film Balzac et la petite tailleuse chinoiseSébastien Travadel, Aurélien Portelli et Franck GuarnieriLa mise en récit de la sûreté nucléaire post-FukushimaSylvie Grenet et Noël CoyeRaconter ou prouver. Récits de découvertes et de non-découvertes de grottes ornéesComptes rendusJulien QuesneSue J. Kim, On Anger: Race, Cognition, NarrativeFederica StefanelliAnna Maria Ortese, Pensare l’alba al fondo di una notte d’invernoMarc MartiUn village français. L’histoire au risque de la fiction de Bernard PapinMarc MartiMohamed Bernoussi, Umberto Eco sémioticien et romancier
↧
Les Lettres de mon moulin : uneœuvre patrimoniale
COLLOQUE DES AMIS DE DAUDET FONTVIEILLE (PROVENCE) 150 e anniversaire des Lettres de mon moulin Les Lettres de mon moulin ont paru en recueil en 1869, il y aura donc 150 ans en 2019. C’est un anniversaire qui fait date puisque le ministère de la culture inscrit l’œuvre aux Commémorations nationales. En 2012, l’Académie française décidait de faire distribuer à tous les élèves de CM 1 un exemplaire des Lettres de mon moulin avec une préface d’Hélène Carrère d’Encausse qui justifiait le choix des académiciens qui voient dans le recueil de Daudet une « œuvre patrimoniale », c’est-à-dire une œuvre qui est le bien de tous et qui a vocation à être partagée dans l’espace francophone. Il semblerait donc utile d’explorer cette piste en s’interrogeant sur la réception des Lettres de mon moulin à la fois sur le plan historique et géographique ainsi que sur son lien avec l’institution scolaire. Le colloque s’attachera aussi à d’autres aspects d’une œuvre très connue mais qui mérite qu’on s’y intéresse à nouveau. Ce recueil – si transparent – a une genèse complexe et, comme bien des œuvres de Daudet, est traversé par des intertextes multiples, populaires ou savants, provençaux et parisiens. Le recueil est construit autour de cycles qui pourraient être étudiés individuellement. L’appartenance des Lettres à un genre littéraire est également problématique : la forme épistolaire domine t-elle ou est-elle le prétexte à des contes, des nouvelles ou des poésies en prose ? Les thèmes sont multiples (nature, amour, etc.) ; les tonalités sont diverses (fantastique, humour, satire, etc.) ; le style est très travaillé. Ce sont autant d’entrées possibles pour mieux étudier ce recueil qui a souffert de bien des simplifications et lectures réductrices. Nous souhaitons donner une ampleur particulière à ce colloque anniversaire centré sur l’œuvre qui est aujourd’hui la plus emblématique de l’écrivain. Les propositions de communications sont à renvoyer à : Anne-Simone Dufief (pierre-anne-simone-dufief@wanadoo.fr) et Gabrielle Melison(gabrielle.melison@univ-lorraine.fr) Elles devront parvenir pour le 31 octobre et seront examinées par le bureau de l’association les Amis de Daudetcourant novembre2019. Les communication seront orales (environ 20 mn) et donneront lieu à une publication dans la revue Le Petit Chose .
↧
Romance Philology , vol. 72-1, 2018
 Romance Philology vol. 72/1, 2018, Brepols, 2018 EAN13 : 9782503578637 TABLE DES MATIERES Jean-Pierre Chambon :Pour le commentaire de Flamenca : sur les vers 460–472 et 594–621 John D. Bengtson :How Do You Solve a Problem Like Euskera? Francesco Carapezza :L’alba in forma di romanza: Sul tipo strofi co e musicale di Reis Glorios ( BdT 242,64) Rosa Mª Medina Granda :La sextina arnaldiana y el poema Ar em al freg temps vengut : ( BdT 43,1) de Azalais de Porcairagues: ¿entrebescamen, rizoma , luego una nueva forma de escritura? Bienvenido Morros Mestres . :Dos posibles enmiendas a unas coplas amorosas: de Jorge Manrique: a propósito de fedra de Séneca Alfonso Zamorano Aguilar :Notas sobre reflexión sintáctica: en la América latina de finales del XIX: Ecuador Review article William D. Paden :The Lives of the Troubadours: A New Biographical Dictionary [Review of Saverio Guida and Gerardo Larghi, Dizionario biografi co dei trovatori (Modena: Mucchi, 2014)] Essays in memoriam Gabriella Macciocca : In ricordo di Eduardo Blasco Ferrer (15 giugno 1956–12 gennaio 2017) Barbara De Marco : Bibliography of Eduardo Blasco Ferrer: Preliminaries to a Volume In Memoriam
Romance Philology vol. 72/1, 2018, Brepols, 2018 EAN13 : 9782503578637 TABLE DES MATIERES Jean-Pierre Chambon :Pour le commentaire de Flamenca : sur les vers 460–472 et 594–621 John D. Bengtson :How Do You Solve a Problem Like Euskera? Francesco Carapezza :L’alba in forma di romanza: Sul tipo strofi co e musicale di Reis Glorios ( BdT 242,64) Rosa Mª Medina Granda :La sextina arnaldiana y el poema Ar em al freg temps vengut : ( BdT 43,1) de Azalais de Porcairagues: ¿entrebescamen, rizoma , luego una nueva forma de escritura? Bienvenido Morros Mestres . :Dos posibles enmiendas a unas coplas amorosas: de Jorge Manrique: a propósito de fedra de Séneca Alfonso Zamorano Aguilar :Notas sobre reflexión sintáctica: en la América latina de finales del XIX: Ecuador Review article William D. Paden :The Lives of the Troubadours: A New Biographical Dictionary [Review of Saverio Guida and Gerardo Larghi, Dizionario biografi co dei trovatori (Modena: Mucchi, 2014)] Essays in memoriam Gabriella Macciocca : In ricordo di Eduardo Blasco Ferrer (15 giugno 1956–12 gennaio 2017) Barbara De Marco : Bibliography of Eduardo Blasco Ferrer: Preliminaries to a Volume In Memoriam
↧